Nous sommes entréEs officiellement au Canada, depuis le 23 mars dernier, en campagne électorale et il en sera ainsi jusqu’au 28 avril prochain. Durant cette courte période, il y aura plusieurs centaines voire même plus d’un millier de personnes qui vont poser leur candidature en vue de se faire élire dans l’une des 343 circonscriptions représentées à la Chambre des communes du Parlement fédéral. Qui dit élection, dit candidates et candidats qui feront, au cours des semaines à venir, « campagne électorale ». Nous sommes maintenant à l’ère de celles qui se déploient entre le contact direct avec l’électrice et l’électeur ainsi que ce qui est diffusé dans les médias électroniques (la radio, la télévision et les journaux) et sur les réseaux sociaux (entre autres choses, Facebook et X). Il est à noter que les spécialistes en communications et en marketing occupent indubitablement, depuis plusieurs décennies, une place de choix auprès des dirigeantEs et des candidatEs des partis politiques. Mais, comme le veut le vieil adage selon lequel « C’est dans les vieux pots qu’on trouve les meilleurs onguents », profitons de la présente occasion pour effectuer un retour sur le Petit manuel de campagne électorale rédigé en 64 avant Jésus-Christ à l’intention de… Cicéron1. Tout au long du présent texte, il sera question des élections dans une démocratie libérale occidentale. Nous dégagerons certaines des caractéristiques de ces campagnes électorales contemporaines et nous formulerons certaines remarques au sujet de celle qui se déroule en ce moment au Canada. Nous focaliserons une partie de notre texte sur ce qui est toujours bien présent dans le paysage et qui remonte aux lointaines campagnes politiques de l’Antiquité romaine. Mais commençons par une remarque à caractère terminologique. D’où vient au juste l’expression « campagne électorale » ?
Du paysager, au militaire… au politique
Parler de « campagne électorale » mérite d’entrée de jeu un certain nombre de précisions. À l’origine, le mot « campagne » désignait une « vaste étendue de pays plat ». Ce sera sous l’influence de la langue italienne (« campagna ») que la locution « se mettre en campagne » prendra une connotation militaire consistant, concrètement, à envoyer des troupes sur un terrain où elles vont se battre pour faire triompher un camp sur un autre. Ce n’est que progressivement que le terme « campagne » sera par la suite employé dans d’autres domaines, comme la politique (« campagne électorale »)2.
Au sujet des élections, on peut suggérer qu’une campagne électorale correspond à la période durant laquelle les candidatEs et leurs partis font leur autopromotion partisane auprès de l’électorat, en vue de récolter le plus grand nombre de voix possible. Dans un plan de campagne électorale, il faut, par conséquent, que les candidatEs qui rivalisent les unEs contre les autres, recrutent des militantEs et des sympathisantEs qui se mettront à leur service et collecteront des ressources financières. La ou le candidatE devra proposer un programme électoral pour les années à venir, le rendre public et le « vendre » par différents procédés de communication (affiches électorales, distribution de « tracts » ou de dépliants électoraux, appels téléphoniques, assemblées partisanes, participation à des débats contradictoires, diffusion de messages ou présence sur les réseaux sociaux, etc.). Il va sans dire que la mobilisation de l’électorat se fera en s’adressant à la passion (et non prioritairement à la raison) des personnes et en ne jouant sur rien de moins que les émotions ou les affects des citoyenNEs.
Dans les démocraties libérales occidentales électives, le vote correspond maintenant à un horizon réputé indépassable. Il s’agit d’un moment fort où la citoyenne et le citoyen sont appeléEs à exprimer leur voix parmi une flopée de candidatEs qui aspirent à siéger au Parlement pour les quatre ou cinq prochaines années, selon les pays. Poser sa candidature suppose toujours d’aller à la rencontre des électrices et des électeurs en vue d’obtenir leur vote. Dès lors, une démarche de conviction ou de séduction se met en branle durant la fameuse période qui correspond à la campagne électorale. Comme mentionné plus haut, celle-ci oscille entre « art agricole » et « art militaire ». De la première, elle emprunte son objectif de récolte ou de cueillette des suffrages, de la seconde elle emprunte ses méthodes : la ou le candidatE devra affronter et combattre son adversaire politique en parcourant de long en large sa circonscription et en organisant la diffusion de sa propagande partisane. Elle ou il comptera sur ses militantEs et sympathisantEs pour faire connaître ses engagements ou ses promesses électorales. C’est ici que peut s’imposer l’accès à un ou à une spécialiste en communication politique qui est réputéE avoir à sa disposition une expertise des manuels portant sur l’art de bien conduire une campagne électorale.
Dans les démocraties électives occidentales, le droit de vote universel et non discriminatoire à l’endroit des femmes est d’origine récente (il s’agit pour l’essentiel d’un processus qui s’échelonne du XIXe au XXe siècle, environ) ; pour ce qui est du manuel de campagne électorale, celui-ci a des origines un peu plus lointaines. On peut même le faire remonter au Ier siècle avant Jésus-Christ et son auteur est nul autre que Quintus Tullius Cicéron, le frère du célèbre sénateur romain Marcus Cicéron.
Au sujet des conseils exposés dans le Petit manuel de campagne électorale
Quintus Tullius Cicéron donne dans son Petit manuel de campagne électorale les principales recettes d’une élection réussie : comment serrer les mains des futurs électeurs (uniquement des hommes à l’époque), leur tenir un discours plaisant. Les méthodes, à ces sujets, n’ont apparemment guère changé. La campagne électorale pourrait en effet se définir comme l’ensemble des opérations mises en œuvre par un candidat pour recueillir le maximum de suffrages à une élection donnée et gagner la « bataille électorale ». Pour se faire, dans la section XI, paragraphe 41, Quintus Tullius Cicéron recommande ceci au sujet des rapports d’un candidat avec le peuple : « de connaître le nom des électeurs, de savoir les flatter, d’être constamment auprès d’eux, de se montrer généreux, de veiller à sa réputation, d’avoir grand air, de faire miroiter des espérances politiques » (p. 36). Bref, le candidat doit se montrer fraternel et amical avec les électeurs, de même que faire des promesses qui annoncent de grandes réalisations étatiques visant à engendrer de vifs espoirs quant au déroulement de l’avenir. Un peu plus loin, au paragraphe 52, Quintus Tullius Cicéron précise ceci au sujet du contenu de la campagne : « applique-toi enfin à ce que ta campagne soit pleine de faste, qu’elle soit brillante, éclatante, populaire, qu’elle se déploie dans une grandeur majestueuse et une dignité sans pareille. Et même, si l’on peut trouver un moyen de le faire, veille à ce que l’on jette l’opprobre sur tes compétiteurs, en évoquant quelque scandale conforme à leurs mœurs (crime, débauche ou corruption). [Et au paragraphe] 53. Dans cette campagne, il faut surtout faire en sorte que l’on nourrisse de sérieux espoirs quant à ta politique et une bonne opinion à ton égard » (pp. 41-42). Autrement dit, faire triompher les apparences d’un avenir meilleur grâce à d’ambitieux et de fastueux engagements électoraux, tout en discréditant, en grande partie ou en totalité, la personnalité et les solutions mises de l’avant par les candidats des camps adverses. Cet ouvrage, écrit il y a plus de deux millénaires, nous donne à penser qu’à travers le temps, le contenu des campagnes électorales a peu varié. Tout se passe comme si les personnes humaines ont peu ou n’ont pas vraiment changé.
Les campagnes électorales depuis l’avènement de la télévision et des réseaux sociaux
Le terme « campagne électorale », qui appartient comme mentionné ci-haut au vocabulaire de l’art militaire, désigne une action collective qui ne fait plus directement appel, dans les démocraties libérales occidentales, à la violence, mais qui n’a pas renoncé à la conflictualité concurrentielle inscrite dans un cadre législatif peu ou fortement codifié, selon les pays. Si les savoir-faire politiques de campagne se sont beaucoup transformés et professionnalisés, notamment sous l’effet de la médiatisation, le travail de sollicitation des électrices et des électeurs relève de différentes approches qui sont à la fois lointaines et contemporaines. Les campagnes électorales comportent tous les éléments constitutifs d’un rituel : publicité visant à faire connaître la ou le candidatE, théâtralisation des débats autour de certains enjeux spécifiques du moment, différenciation des fonctions entre les différentEs spécialistes qui oeuvrent dans les partis politiques, etc.. La répétition des élections a engendré un savoir-faire électoral spécialisé qui se façonne par la pratique et se diffuse notamment à travers les manuels électoraux3. La relation électorale entre la ou le candidatE et la ou le citoyenNE se définit comme un échange de promesses énoncées dans le programme politique du parti.
En Occident, le XXe siècle constitue une période fondatrice en ce qu’elle formalise la transaction électorale et cristallise certains savoir-faire, en jetant les bases des campagnes électorales réussies. Pour avoir des chances de gagner, la ou le candidatE doit désormais mobiliser des ressources à la fois personnelles (sa famille, sa biographie, sa réputation), qui supposent une rationalisation du travail de l’image de soi et de son enracinement dans le parti (ses réseaux, son électorat, son financement, ses supportrices et ses supporteurs) que confère notamment l’investiture partisane. Mais si les campagnes électorales se sont beaucoup transformées dans le sens d’une professionnalisation, d’une standardisation et d’une rationalisation, elles restent des conjonctures fluides. Le travail de mobilisation électorale préserve encore aujourd’hui son caractère traditionnel de rencontre de personne à personne (à caractère artificiellement fraternel), qui lui remonte jusqu’à l’époque de Cicéron.
Les manières de « faire campagne » et les répertoires d’action électoraux ont certes subi des transformations depuis le siècle dernier. Mais dans le cadre des campagnes électorales couvertes par la télévision et l’achat de publicité dans les médias écrits et électroniques, les candidatEs qui ont des chances d’être éluEs sont celles et ceux qui peuvent compter sur un parti fortement centralisé, aux ressources professionnelles compétentes et disposant d’une caisse électorale bien garnie. Il en est ainsi, car il en coûte de plus en plus cher pour rejoindre et convaincre les électrices et les électeurs. Désormais soumise à une concurrence de plus en plus forte, la conquête des positions de pouvoir implique un travail de mobilisation obéissant à une logique de persuasion de plus en plus simplifiée.
Les techniques de campagne se standardisent et se professionnalisent à mesure que se développe le recours aux médias, aux sondages (à la fois portrait et construction de l’opinion publique) et aux savoir-faire de la communication politique. Ainsi, la réunion publique et les assemblées locales ont perdu, à travers le temps, leur place centrale dans la communication électorale. C’est dans les médias d’information traditionnels et sur les réseaux sociaux que se jouent maintenant les campagnes électorales. Le rôle de l’image est reconnu maintenant comme un élément distinct et capital de la candidate et du candidat, indépendamment de son programme ou de l’organisation partisane qui l’investit. Dans ces conditions, faire campagne consiste surtout à influencer et contrôler ce que l’électorat doit percevoir des enjeux diffusés dans les médias. Autrement dit, la campagne représente une lutte visant à imposer son propre programme politique dans l’agenda public et médiatique. Le chef du parti doit, de son côté, percer l’écran et se faire reconnaître minimalement comme le titulaire ou l’expert de l’enjeu principal de l’élection. Nous y reviendrons un peu plus loin dans le cas, plus spécifiquement, du chef du Parti libéral du Canada, Marc Carney.
La transformation de la société
Nous vivons au sein d’une société qui traverse présentement un moment particulier, soit le bouleversement des règles du jeu en matière de commerce international. De plus, la lutte pour le progrès social, fondée jusqu’à tout récemment, sur une vision universaliste, est en ce moment éclipsée par une grande menace aux droits et libertés. Cette menace a pour nom le président des USA : Donald Trump. Ajoutons qu’il n’y a pas, par les temps qui courent, d’acteur central qui peut formuler un projet de société susceptible de susciter une adhésion large de la masse populaire. Il est par conséquent difficile d’envisager la formulation d’un idéal réaliste à atteindre susceptible d’inspirer la pluralité des mouvements sociaux et d’influencer, par ricochet, les programmes électoraux des partis politiques. La menace qui nous pèse au bout du nez et qui borne notre horizon immédiat se résume prioritairement, pour certaines personnes, dans la formule restrictive des tarifs douaniers.
Ce qui caractérise la présente campagne électorale au Canada
La présente campagne électorale devrait être celle du bilan des dix dernières années du gouvernement libéral sortant et des solutions à mettre en place pour résoudre des enjeux comme les changements climatiques, la répartition de la richesse, l’éducation, la santé, etc.. Mais par un curieux retournement de la conjoncture, elle porte plutôt sur l’heure de la guerre des tarifs douaniers. Il y a retour du balancier, puisqu’en 1988, la campagne avait aussi porté sur un seul enjeu, mais à l’inverse : celui du Libre-échange entre les USA et le Canada. En ce moment, nous assistons à une lutte entre deux chefs. Lequel a une histoire personnelle qui favoriserait le succès d’une éventuelle négociation avec le président étatsunien Donald Trump ? C’est du moins ce que l’actuel chef du Parti libéral du Canada et premier ministre non élu, Marc Carney, semble vouloir faire en inscrivant sa propre histoire de « Banquier à succès » dans celle de la bataille des tarifs douaniers. L’« autoréférentialité » du discours de la campagne électorale de Marc Carney participe de la fermeture du jeu politique sur lui-même, où les calculs électoraux (ceux des candidats [commentés par les journalistes] et ceux supposés de l’électorat) priment hélas sur les enjeux environnementaux, sociaux, culturels, etc.. Malgré tout, un autre rappel historique peut servir à justifier sa popularité. En souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne aurait-elle survécu à l’hostilité nazie si Chamberlain avait continué son rôle de Premier ministre ? Winston Churchill n’était peut-être pas la figure la plus populaire du moment, mais il représentait l’homme que la nation avait besoin. Il existe des périodes où tout va si bien qu’un pantin aurait autant de succès qu’une personne ultra compétente. À l’inverse, il y a des périodes qui exigent de se tourner vers des gens aux qualités particulières, en raison d’un contexte extraordinaire. Car nous ne sommes pas toutes et tous aptes à faire face à une guerre. Ainsi, Marc Carney peut être perçu comme l’homme dont le Canada a besoin à l’heure actuelle, en raison des peurs qui ébranlent la population. Encore une fois, tout est une question de point de vue.
Conclusion
En démocratie représentative élective, lors d’une élection générale, les dirigeantEs ne sont pas « éluEs », mais « se font élire » et ce surtout dans le cadre d’un mode de scrutin uninominal à un tour. D’abord, le rôle du peuple consiste pour l’essentiel à ceci : il doit se confiner dans la position d’un spectateur qui se contente d’apprécier certains engagements ou promesses électorales à partir de la performance verbale des candidates et candidats en lutte pour obtenir son vote. Ensuite, le dénouement du vote ne doit pas être interprété comme le résultat de l’intérêt spontané des individus pour la politique, bien plutôt comme le produit d’un travail d’enrôlement des citoyenNEs par les professionnelLEs de la politique. Une chose est certaine : la présente campagne électorale fédérale nous donne et donnera à voir et à observer moult et maints exemples de candidates et de candidats spécialistes des engagements flous, lointains et surtout expertEs de la rhétorique, du slogan et de la solution supposément « définitive » à plusieurs problèmes. Il faut se le dire, en campagne électorale les citoyennes et les citoyens se font et se feront asséner, jour après jour, des déclarations provocantes, des petites phrases insignifiantes, des formules-chocs redondantes, des promesses merveilleuses et nous en passons…
Il nous sera difficile, dans le cadre de la présente campagne électorale, de réinventer de nouvelles pratiques qui paraissent nécessaires à la refondation des solidarités en vue de résoudre les nombreux problèmes qui nous assaillent, qui nous interpellent et que les partis politiques préfèrent à peine mentionner ou ne pas aborder, et ce uniquement parce qu’ils savent qu’au cours des prochaines années il se peut que l’agenda des crises à résoudre soit constitué d’autres enjeux pour lesquels ils n’auront soumis aucune perspective de solution4. Ils auront alors carte blanche pour y aller de leurs solutions improvisées et antipopulaires à caractère idéologique, qui font peu de cas de la dimension sociale ou écologique. Quoi qu’il en soit, nous aurons droit à de nombreuses promesses qui, une fois les candidatEs éluEs, seront rapidement remisées au rayon des promesses mirobolantes non tenues… Et ainsi va minimalement la vie politique depuis Cicéron !
En fin de compte, la critique à adresser au système des partis politiques en campagne électorale est la suivante : il s’agit de celle de la bureaucratie étatique et partisane. Le système de gouvernement représentatif connaît aujourd’hui une crise en partie parce qu’il a perdu, avec le temps, toutes les institutions qui pouvaient permettre une participation effective des citoyenNEs et, d’autre part, parce qu’il est gravement atteint par le mal qui affecte le système des partis politiques tel que diagnostiqué par Moisei Ostrogorsky et Robert Michels au siècle dernier, c’est-à-dire la bureaucratisation et la tendance des deux grands partis politiques à ne représenter que leurs appareils. C’est le phénomène du gouvernement de l’anonymat, celui des candidatures errantes qui parviennent à se faire élire à l’aide d’une kyrielle de promesses aux solutions illusoires condensées dans un programme électoral : un programme « mirage ».
Sommes-nous alors dans la duperie et le mensonge ? Sinon dans la courtisanerie laissant sous-entendre une tendance hypocrite, du sens de Hannah Arendt ? Et pourquoi ne pas rappeler Quinte-Curce pour qui le meilleur moyen de gouverner la multitude est l’usage de la superstition ? D’abord, l’hypocrite signifie « comédien » en grec, mais il s’agit surtout d’un comédien dont l’art de jouer lui retombe dessus inévitablement, car s’il sait berner autrui, en espérant que celui-ci le croit vertueux comme il le dit, il en vient en plus à se mentir à lui-même, cherchant donc à convaincre de ce qu’il n’est pas. En bref, le crime de l’hypocrite se résume à « un faux témoignage contre lui-même », ce qui revient à considérer l’hypocrisie comme « le vice grâce auquel la corruption devient manifeste » (Arendt, 2012, pp. 156-157). La distraction de la campagne électorale peut alors dissimuler sous son masque un échange particulier entre des contributeurs et des offreurs de promesses conditionnelles à la victoire. Bien entendu, il s’agit ici de se remémorer certains faits malheureux de l’histoire des campagnes électorales, en espérant une avenue vertueuse de celle qui nous concerne actuellement. Ensuite, la superstition est ce qui sert à adorer des dieux, des rois, des dirigeantEs, mais aussi à les détester. Car la cause « d’où naît la superstition, qui la conserve et l’alimente, est donc la crainte […] » (Spinoza, 1965[1670], p. 20). Si la superstition fut utile à rattacher les fidèles aux grandes religions et aux anciens États, elle demeure toujours d’actualité et s’est donc ajustée au goût du jour. Pour éviter le châtiment, une action doit être posée pour alléger l’humeur ou la dangerosité de la chose menaçante ; par exemple, pour éviter des pressions inflationnistes et avoir plus d’argent dans nos poches, il faut voter pour le parti qui promet des baisses d’impôt et les meilleures mesures de croissance économique, comme si tout pouvait être régulé par la force du politique. Superstition et croyance vont ainsi de pair.
Par ailleurs, dans la mesure où leur efficacité ne peut jamais être véritablement établie, les répertoires d’action et les techniques de mobilisation électorale sont dotés d’une forte inertie. Certaines formes de mobilisation électorale, apparues aussi loin que l’Antiquité romaine, continuent de perdurer. La médiatisation n’a pas supprimé les médiations traditionnelles d’une campagne électorale. Faire campagne, c’est toujours, même à l’ère de la démocratie médiatique contemporaine, « serrer les mains » et distribuer des dépliants électoraux et des macarons à l’effigie de la candidate ou du candidat. Faire campagne, c’est donc, dans une conjoncture et sur un territoire donnés, recourir à un répertoire de techniques plus ou moins stabilisées, dont la ou le candidatE présuppose l’efficience, et dont l’usage est fonction de la représentation qu’il se fait de son électorat et de leurs attentes et de leurs préférences. Ces techniques apparaissent à la fois en constante transformation et marquées par une certaine continuité. Si une rationalisation des pratiques politiques et électorales est à l’œuvre, notamment à travers le rôle du marketing politique, et si le volume total des ressources de toutes sortes nécessaires pour l’emporter dans la compétition politique tend à augmenter, faire campagne revêt toujours l’aspect laborieux d’une incontournable et nécessaire « besogne électorale » qui consiste à aller à la rencontre des gens. La lutte et les campagnes électorales restent fortement contraintes par la structure des interactions sociales et le travail de mobilisation de l’électorat en vue de faire sortir le vote partisan. Elles relèvent, par conséquent, de pratiques préexistantes et de concurrences routinières, ancrées dans le temps long. Se pose ici une question : est-ce ainsi que nous croyons vraiment un jour venir à bout de ces nombreux maux auxquels nous sommes constamment confrontéEs ? Élections, piège à quoi encore5 ?
Guylain Bernier
Yvan Perrier
4 et 5 avril 2025
14h
Références
Arendt, Hannah. 2012. De la révolution. Paris : Gallimard, 502 p.
Baudart, Anne. 2005. Qu’est-ce que la démocratie. Paris : Vrin, 128 p.
Beaumont, Stéphane. 1997. Le jeu politique. Toulouse : Les éditions Milan, 63 p.
Charlot, Jean. 1971. Les partis politiques. Paris : Armand Colin, 255 p.
Coche, Marie-Ève et Émilie Muraru. 2022. « La démocratie ». Documentation photographique, 2022, no. 2, 65 p.
Haegel, Florence. 2024. La science politique. Paris : SciencesPo Les Presses, 377 p.
Lambert, Frédéric et Sandrine Lefranc. 2014. 50 fiches pour comprendre la science politique. Paris : Bréal, 223 p.
Lefebvre, Rémi. 2024. « Le travail de mobilisation électorale ». In Cohen, Antonin (dir.). Nouveau manuel de science politique. Paris : La Découverte, p. 423-439.
Michels, Robert. 2009. Les partis politiques. Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles, 271 p.
Offerlé, Michel. 2024. « Partis et configurations partisanes ». In Cohen, Antonin (dir.). Nouveau manuel de science politique. Paris : La Découverte, p. 465-478.
Ostrogorski, Moisei. 1979. La démocratie et les partis politiques. Paris : Éditions du Seuil, 312 p.
Quintus Tullius Cicéron. 2015. Petit manuel de campagne électorale. Paris : Rivages poche, 143 p.
Spinoza, Baruch. 1965[1670]. Traité théologico-politique. Paris : GF-Flammarion, 380 p.
Spinoza, Baruch. 1966[1677 et 1661-1676]. Traité politique. Lettres. Paris : GF-Flammarion, 379 p.
Notes
1. Quintus Tullius Cicéron. 2015. Petit manuel de campagne électorale. Paris : Rivages poche, 143 p. Il est à noter que nous avons lu, à plus d’une reprise, que certains spécialistes doutent de l’authenticité de l’auteur du manuel.
2. Rey, Alain (dir.). 1993. Dictionnaire historique de la langue française. Tome 1. Paris : Dictionnaire Le Robert, p. 335.
3.Voir à ce sujet les nombreux ouvrages explicatifs disponibles sur le NET au sujet des règles électorales afin d’aider les candidatEs et de permettre aux électrices et aux électeurs d’exercer leur droit de vote.
4.C’est la grande leçon qu’il faut retenir de la campagne électorale de 1988 qui a porté sur un seul enjeu (le libre-échange Canada-USA). Les cinq années suivantes ont été entre autres choses consacrées à l’échec de l’entente du Lac Meech, au rejet de celle de Charlottetown et à l’adoption de la taxe sur les produits et services (TPS).
5. « Élections, piège à cons » (Jean-Paul Sartre). Issu du vocabulaire militaire, le « piège à cons » désigne un leurre grossier dans lequel seuls les faibles d’esprit peuvent tomber....
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :





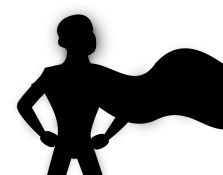

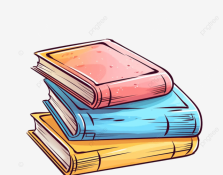





Un message, un commentaire ?