« Rien n’a, comme l’argent, suscité parmi les hommes de mauvaises lois et de mauvaises mœurs ; c’est lui qui met la discussion dans les villes et chasse les habitants de leurs demeures ; c’est lui qui détourne les âmes les plus belles vers tout ce qu’il y a de honteux et de funeste à l’homme et leur apprend à extraire de chaque chose le mal et l’impiété. » (Sophocle, dans Antigone)
Le 6 mars 2025, le président étasunien, Donald Trump, annonçait avoir signé un décret permettant de constituer une « Réserve stratégique de bitcoins » ainsi qu’un stock d’autres actifs numériques (Maruf & Morrow, 2025, 6 mars). Par le fait même, les États-Unis feraient partie des premiers pays à détenir officiellement et, par conséquent, à valoriser et à conserver une masse monétaire numérique. En revanche, il est possible d’observer à l’intérieur de l’administration Trump une prédisposition de ses plus hauts dirigeant.e.s, dont le président lui-même, à vouloir s’enrichir par la cryptomonnaie. Si l’invention n’est pas nouvelle, la mainmise d’un État sur des avoirs de cette sorte expose un changement notable dans les politiques monétaires, au point d’envisager une suite logique du processus historique faisant passer, pour nous restreindre utilement à ces courants, le mercantilisme à l’étalon-on et au monétarisme, afin d’en arriver enfin au « cryptomonétarisme ». Ces notions, doctrines ou régimes seront d’ailleurs définis dans les lignes qui suivront. Il n’empêche que la dernière évolution nous intéressera davantage, au point de susciter un questionnement éthique, puisque des dirigeant.e.s d’un gouvernement sont à la fois législateurs et investisseurs ou même propriétaires de plateformes numériques ; en l’occurrence, cela pousse à nous demander en quoi le marché de la cryptomonnaie diffère-t-il à ce point du marché des monnaies traditionnelles et des métaux précieux, comme l’or ?
De la lettre de change vers l’accumulation de métaux précieux
Avant l’époque de la Renaissance, l’enrichissement reposait sur les guerres, les conquêtes et donc les spoliations des adversaires ; ce qui insinue évidemment une création de la richesse préalable par l’agriculture, le travail artisanal et l’exploitation minière. Même si la monnaie était présente, elle restait peu utilisée par l’ensemble de la population, étant en quelque sorte une marque distinctive de la classe dirigeante et jusqu’à un certain point marchande. Mais avec l’organisation des marchés de l’Europe occidentale, suivant le XIVe siècle, l’apparition des lettres de change a permis des transactions entre les cités-États ou les royaumes. En raison de la présence de diverses monnaies, aux valeurs disparates et sujettes à la volatilité, une mesure d’équivalence devait être établie pour assurer la confiance. Comme l’explique Jean Delumeau (1984, p. 214), la spéculation existait certes, mais rien n’empêchait une entente sur les cours de change, dans la mesure où l’équilibre du marché pouvait être obtenu selon les « places » cotant le « certain » et celles cotant l’« incertain ». Par exemple, au XVe siècle, la trajectoire d’échange portant sur l’écu de Flandres entre Bruges (en Belgique) et Barcelone (en Espagne) « était toujours coté sur les deux places en un nombre variable de sous et de deniers catalans » (Delumeau, 1984, p. 214), alors que Bruges procurait le certain et Barcelone l’incertain. Ainsi, la stabilité « relative » des ententes monétaires se faisaient par comparaison entre plusieurs places bancaires, et ce, en fonction des lettres de change qui concernaient les prix et les marchandises. Et puisque la valeur des monnaies et des changes était largement déterminée par les souverains, les firmes bancaires s’assuraient d’avoir leurs représentants dans les cours. Ce qui captait davantage l’intérêt des grands banquiers-marchands de la Renaissance représentait les affaires financières – les prêts et la spéculation sur les lettres de change – plutôt que l’essor de l’industrie (Delumeau, 1984). Ainsi, accumuler un stock monétaire et des profits devenait une priorité, d’où la promotion du quantitatif qui mena naturellement vers le mercantilisme.
Ce régime peut être compris comme une entrave à la liberté des échanges ou encore comme un système permettant d’accroître la puissance d’un royaume, car il s’agit de l’époque qui a permis de constituer les États nations. Cela dit, Adam Smith (2009[1776]) dans sa Richesse des nations fut d’ailleurs critique à l’endroit du bullionisme pratiqué en Espagne particulièrement durant le XVIe siècle ; par bullionisme – dérivé du terme anglais « bullion » qui signifie « lingot » –, il est question d’une pratique consistant à l’enrichissement d’un État par l’accumulation de métaux précieux, tels que l’or et l’argent, tout en interdisant leur exportation sous peine de sanctions (Spector, 2003, p. 290). Ainsi, l’idée préconçue selon laquelle l’argent fait la richesse dominait les pensées et supposait sa réalisation possible uniquement dans l’abondance d’or et d’argent.
Après avoir exploité les ressources des mines d’Europe en ce sens, l’exploration de l’Amérique (et la colonisation de l’Amérique centrale et des deux continents [Amérique du Nord et Amérique du Sud]) ouvrit la voie à une montée des importations de métaux précieux soutirés du sol des nouvelles colonies. Comme le souligne Smith (2009[1776], pp. 134 et 138), le mercantilisme fait perdre de vue la raison d’être de la monnaie, « comme instrument de commerce et comme mesure des valeurs », afin de devenir une fin en elle-même, alors que la richesse, pour lui, se réalise pourtant dans l’échange : « […] la richesse ne consiste pas dans l’argent ou dans la quantité de métaux précieux, mais dans les choses qu’achète l’argent et dont il emprunte toute sa valeur, par la faculté qu’il a de les acheter ». D’ailleurs, les entraves au commerce et la recherche excessive d’or et d’argent ont causé la banqueroute de l’Espagne, et c’est sans compter la tendance de l’époque à retirer en panique les dépôts des banques à la moindre alerte (Delumeau, 1984). Il n’empêche que l’Espagne voyait dans son bullionisme l’occasion d’affirmer sa suprématie sur les autres États, mais n’a point su toutefois encourager son industrie au même titre que la France.
Car le mercantilisme peut aussi revêtir les apparats du colbertisme, en favorisant toujours l’accumulation des métaux précieux, sans pour autant restreindre totalement leur exportation. Pour Colbert, la puissance de l’État s’associe à la prospérité économique, dans le sens selon lequel l’accumulation de métaux précieux doit se faire par le commerce et l’industrie, alors que des mesures protectionnistes viennent protéger le marché intérieur et une réglementation encadre en plus l’industrie (Spector, 2003)[1]. Il s’agit à la fois d’un processus d’enrichissement, mais surtout de la constitution d’une réserve, voire d’un trésor. En revanche, emmagasiner pour emmagasiner sert à quoi ? C’est justement la concrétisation de l’idée selon laquelle la richesse correspond à l’accumulation d’une masse précieuse surpassant celles des autres. Voilà l’intérêt, l’ambition, la cupidité, l’orgueil, l’ego, etc. Par la suite, l’inflation et la dilapidation dans des dépenses de luxe feront du tort, au même titre qu’a connu l’Espagne qui a totalement déréglé son économie (Fauquier, 2018).
Mais l’or et l’argent restent associés à la monnaie. Comme le dit Joseph Rambaud (1909, p. 107) : « […] si l’on est mercantiliste, ce n’est pas que la monnaie soit la richesse par excellence : c’est tout simplement parce qu’elle est la forme la plus facilement réalisable et qu’à cet égard on a bien vite conclu de l’économie privée à l’économie publique, pour étendre à l’État tous ces avantages que la possession de la monnaie procure aux particuliers ». Encore une fois, malgré quelques innovations, la stabilité des monnaies demandait toutefois à être concrétisée. Au même titre que nous pourrions critiquer le bitcoin de nos jours, les monnaies de la Renaissance subissaient gravement les ambitions des plus puissants, ici les souverains, mais aussi les aléas de dame Nature, tout en étant alors sujettes à la spéculation et donc à une forte volatilité. Comparer une monnaie avec une autre n’apportait pas la confiance voulue, d’autant plus que les variations de l’une avaient un impact sur l’autre et vice versa. Par conséquent, il fallait s’entendre sur une unité de comparaison extérieure commune, voire un étalon.
Des étalons, encore le gain de l’or et le tournant monétariste
Puisque les États s’intéressaient particulièrement à l’or et à l’argent, en raison de leur valeur reconnue universellement, pourquoi alors ne pas en faire des étalons ? Ainsi, dans les efforts visant à stabiliser les monnaies et à renforcer les systèmes de marché, on en est venu à établir une relation d’entente entre la production d’or et d’argent avec la formation d’une masse monétaire. Les deux étalons se sont donc côtoyés un bon moment, jusqu’à la crise bancaire de 1873[2] qui a donné l’avantage à l’or, considéré plus solide dans le maintien de la monnaie. Mais l’abandon de l’étalon-argent ou encore celui bimétallique au profit de l’or ne s’est pas fait en vertu d’un accord entre les pays (Weber, 2016). Il s’agissait plutôt d’actes indépendants qui imitaient la décision des États ayant une place prépondérante sur les marchés. En 1821, l’Angleterre adopta « légalement » l’or comme seul support à sa monnaie ; l’Allemagne abandonna l’argent au profit du mark-or en 1872, après avoir reçu d’importants dédommagements de la France aux lendemains de la guerre franco-prussienne de 1870 ; le Canada, de son côté, se tourna également vers l’étalon-or en 1853, tandis que la France cessa son utilisation de l’étalon bimétallique en 1878 et les États-Unis, avec la reprise de la convertibilité des billets du pays en or, s’y soumirent en 1879 – par contre, la Loi sur l’étalon-or étasunienne ne fut adoptée qu’en 1900 (Weber, 2016).
Comme l’explique Karl Marx (1968[1867], p. 178), l’or pouvait fonctionner comme un équivalent à toute autre marchandise ; plus que cela, il procurait « à l’ensemble des marchandises la matière dans laquelle elles expriment leurs valeurs comme grandeurs de la même dénomination, de qualité égale, et comparables sous le rapport de la quantité ». Ainsi, comme mesure universelle des valeurs, l’or pouvait être associé à la monnaie. S’ajoute aussi sa fonction d’étalon des prix, car, « [c]omme mesure des valeurs, il sert à transformer les valeurs des marchandises en prix, en quantités d’or imaginées » ; ensuite, « [c]omme étalon des prix, il mesure ces quantités d’or données contre un quantum d’or fixe et subdivisé en parties aliquotes » (Marx, 1968[1867], p. 183). C’est le principe d’adosser la monnaie à un équivalent en or qui assurait la stabilité désirée[3]. Sous l’étalon-or, les banques centrales et les trésors pouvaient émettre des monnaies fiduciaires, à savoir des billets de banque – ou monnaie papier – qui, sans être garantis à 100 % par l’or, devaient être remboursés contre une quantité d’or spécifique (Weber, 2016). Karl Polanyi (1983[1944], p. 271) l’explique bien : la monnaie-marchandise associée à l’or était vitale pour le commerce extérieur, tandis que la monnaie fiduciaire l’était pour le commerce intérieur, d’où leur union jugée essentielle à l’époque. Et puisque le marché extérieur avait une grande influence sur les activités intérieures, il fallait un mécanisme qui assurerait une bonne marche et une stabilité dans les échanges et entre les monnaies.
Voici un résumé de ce mécanisme : tout d’abord, à l’intérieur du pays, l’augmentation des prix ou l’inflation découlerait d’une dissymétrie entre le stock d’or monétaire qui augmente plus vite comparativement au taux de croissance de la production réelle d’or, ce qui signifie, à l’inverse, une baisse des prix ou une déflation lors d’une augmentation moins rapide du stock d’or monétaire comparativement au taux de croissance de sa production réelle. La stabilité s’obtiendrait donc à la fois dans la relation entre la monnaie et l’or ainsi que dans leur quantité ; et l’or joue ici un rôle majeur. Alors, si la production d’or augmente trop vite, causant une inflation, le mécanisme d’ajustement naturel ferait en sorte de rendre plus coûteuse la production d’or par la hausse des prix, ce qui entraînerait une diminution du besoin d’en produire et rétablirait lesdits prix. À l’inverse, la déflation encouragerait l’exploration et la production d’or, créant alors une inflation pour revenir à la stabilité (Weber, 2016). Ensuite, pour s’assurer le bon fonctionnement de ce mécanisme dans un contexte d’échange avec les autres pays, tous les partenaires devaient se conformer à l’étalon-or ; non seulement pour garantir une solidité monétaire et une confiance dans l’échange, mais parce que la monnaie fiduciaire d’un pays ne pouvait circuler sur le sol d’un autre (Polanyi, 1983[1944]). Dès lors, l’exigence de deux prérequis : l’arbitrage[4] de l’or entre les pays et évidemment le maintien par chacun d’une réserve d’or. Ainsi, selon la théorie quantitative de la monnaie, le niveau des prix dans un pays augmente lorsqu’il importe de l’or et diminue lorsqu’il en fait sortir (Weber, 2016). Cela se répercute sur la balance des paiements[5], puisque si elle est excédentaire, il y aura eu entrée d’or ce qui fera augmenter la masse monétaire et, par ricochet, le niveau des prix ; ensuite, cette hausse des prix sur les biens tend à les rendre moins attrayants pour les pays étrangers, faisant ainsi réduire l’excédent de la balance. Bien entendu, l’inverse s’explique sensiblement de la même façon. En bref, la circulation d’or se répercute sur la balance des paiements, dont le solde excédentaire ou déficitaire entraîne des variations de la masse monétaire, d’où des répercussions sur les prix qui viendraient compenser le déséquilibre de départ.
Cet ajustement presque automatique de la balance des paiements sous l’étalon-or donne aussi l’avantage d’empêcher, dans une certaine mesure, les pays à vouloir modifier la teneur en or de leurs monnaies fiduciaires, soit à des fins de dévaluation, soit de réévaluation, afin de dégager des excédents ou de combler des déficits (Weber, 2016). Pour être plus clair, l’étalon-or permettait de faire baisser les prix dès que le taux de change était menacé de dépréciation, mais aussi la hausse du taux de change entraînait une augmentation des prix via l’injection d’or, comme il le fut précisé plus tôt (Polanyi, 1983[1944]). Malgré ses avantages, l’étalon-or a pourtant été abandonné, et ce, peu avant et pendant la Grande Dépression des années mille neuf cent trente[6]. Pourquoi ? Selon Warren E. Weber (2016), les pays adhérents n’ont jamais réellement respecté ses mécanismes ; autrement dit, leur autorité monétaire n’ajustait pas leurs taux directeurs en fonction des entrées et des sorties d’or affectant la balance des paiements ou, lorsqu’elle le faisait, c’était pour agir en sens contraire. De plus, l’engagement de rembourser par de l’or les émissions de monnaie fiduciaire restait conditionnel à chaque pays, et n’a pas été respecté. Mais un pays pouvait déroger de cet engagement en raison d’un cas de force majeur, par exemple, une guerre ou une crise financière. L’urgence passée, il devait ensuite revenir à la convertibilité de la monnaie et de l’or à parité ; ce qui signifiait aussi de ramener les taux de change entre les pays à ce qu’ils étaient. Polanyi (1983[1944]) abonde dans le sens de Weber, puisque les puissances de l’époque, à savoir la Grande-Bretagne et les États-Unis, subitement en difficulté, se sont mis à manipuler leurs monnaies. Parce qu’il faut comprendre qu’avec les méthodes utilisées par les banques centrales, la gestion des crédits s’est améliorée et, de surcroît, la force des monnaies fiduciaires, rendant ainsi caduques les règles automatiques de l’étalon-or. Ce qui allait alors dominer par la suite sera le pouvoir d’achat offert par la monnaie.
En bref, si les pays ont adopté l’étalon-or, c’était d’abord afin d’assurer la stabilité des taux de change avec leurs partenaires commerciaux également convertis. Le mécanisme d’arbitrage causait toutefois des coûts, ce qui occasionnait aussi une variation des taux de change entre les diverses monnaies fiduciaires, d’où des déviations aux règles de l’étalon. Cette variabilité des cours différait cependant en raison de la proximité géographique et l’étroitesse des liens économiques et financiers entre les pays qui transigeaient leur or. Ainsi, le coût d’arbitrage s’avérait moindre entre le Canada et les États-Unis comparativement à ce dernier et la France, par exemple. Tout compte fait, l’abandon de l’étalon-or se justifie par l’organisation des banques centrales et l’amélioration de la stabilité des monnaies et des taux de change. Cela n’a pas empêché le recours à l’or comme valeur refuge ni de considérer aussi certaines monnaies, comme le dollar US et la Livre sterling.
Si le keynésianisme, prêchant une intervention de l’État afin de renverser la Grande Dépression et donc les poussées déflationnistes, avait la cote, il s’est toutefois rapidement heurté au choc pétrolier et à la crise du début des années soixante-dix, prophètes à la fois de l’inflation, du chômage et de la récession. Cet épisode attira l’attention sur ce qui deviendra le monétarisme[7] de Milton Friedman, économiste et statisticien étasunien, pour qui la Grande Dépression et les difficultés survenues par la suite furent causées justement par des manipulations des masses monétaires par les banques centrales ; autrement dit, elles sabotaient par leurs politiques l’autorégulation naturelle des marchés (Aftalion & Poncet, 1984). Dans ce cas, l’inflation s’expliquerait uniquement par le déséquilibre causé par une quantité de monnaie supérieure par rapport aux besoins économiques nationaux. Ainsi, la meilleure politique monétaire consisterait « à maintenir un taux d’expansion monétaire régulier compatible avec une croissance non inflationniste » (Aftalion & Poncet, 1984, p. 6). En d’autres termes, la solution se résume à trouver la bonne quantité de monnaie pour créer un pouvoir d’achat constant.
Cette approche théorique a influencé le néolibéralisme sous Ronald Reagan et Margaret Thatcher (père et mère du néo-conservatisme). Or, sa simplicité suppose d’ignorer plusieurs facteurs susceptibles d’agir sur l’évolution des marchés, ce qui peut certes se répercuter sur la monnaie. Mais encore une fois, l’esprit derrière la richesse repose sur la possession d’argent – de monnaie –, ramenant au jour l’idée préconçue soulignée par Adam Smith quelques siècles plus tôt. Ainsi, le monétarisme a été rapidement délaissé pour favoriser des politiques discrétionnaires.
Une monnaie virtuelle et cryptée, un nouveau monde
Par un saut qualitatif volontaire, en atterrissant dans les années qui suivirent la crise financière de 2008, occasionnée par des produits financiers douteux, l’appât du gain et l’illusion voulant que certaines banques fussent « trop grandes pour faire faillite » (Stuckler & Basu, 2014), se produisit le 22 mai 2010 l’événement baptisé le « Bitcoin Pizza Day » (CryptoVantage, s.d.). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la première transaction dans le monde réel à l’aide du bitcoin a servi à acheter deux pizzas payées par une personne vivant en Angleterre, commandées à une pizzeria des États-Unis pour être livrées à quelqu’un d’autre habitant la Floride. On vient de sortir d’une crise financière majeure, associée à des produits financiers jugés « dangereux », et voilà l’apparition d’une monnaie virtuelle de prime abord sans appui de garantie et donc spéculative et volatile. Peu importe, si l’idée de la cryptomonnaie est apparue dans les années quatre-vingt-dix, avec ensuite quelques essais infructueux[8], il fallut attendre le livre blanc intitulé Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System (2008) qui impliquait le mode de fonctionnement du « blockchain », c’est-à-dire un système dans lequel les transactions en bitcoin peuvent être enregistrées et maintenues dans plusieurs ordinateurs reliés entre eux pour former un réseau. Car l’idée derrière la création de la monnaie virtuelle reposait notamment sur la possibilité d’envoyer des sommes d’argent protégées, et ce, sans même l’intervention d’une entité officielle (CryptoVantage, s.d.). Autrement dit, les initiateurs souhaitaient créer une monnaie libre de toutes contraintes du monde réel, mais pouvant aussi agir sur lui. Ainsi, le premier bloc du réseau bitcoin, baptisé Genesis Bloc ou « Bloc de la Genèse », a été mis en activité le 3 janvier 2009, alors que les premières transactions sont survenues en avril 2010 et le mois suivant les pizzas ont pu être achetées (CryptoVantage, s.d.).
Depuis, le marché des cryptomonnaies a subi une expansion. Au bitcoin se sont greffés d’autres grands joueurs, tels qu’Ethereum, Solana, Cardano, Tezo, etc., en plus des mèmes qui ont fait leur entrée – nous y reviendrons. Cette liberté offerte par le cyberespace a attiré évidemment autant les investisseurs vertueux que les spéculateurs et les fraudeurs. En 2014, la plus importante plateforme d’échange du monde, à savoir Mt. Gox, s’effondra et déclara faillite après la perte de 850 000 bitcoins (CryptoVantage, s.d.). Le réflexe exigea d’encadrer et de sécuriser davantage les plateformes. Par contre, il n’est pas aisé de retracer les malfaiteurs, puisque toutes les opérations en cryptomonnaies se font dans l’anonymat. Depuis 2019, les principales plateformes se sont dotées de garanties sur leur réserve de cryptomonnaies en cas d’attaque informatique ; il s’agit de fonds sécurisés d’urgence comme celui de Binance (CryptoVantage, s.d.). Par ailleurs, l’ampleur et l’engouement suscités par les cryptomonnaies, surtout le bitcoin, ont forcé la prise de conscience d’une nouvelle réalité monétaire, d’autant plus que le cyberespace demeure encore à ses premiers balbutiements.
Une nouvelle fois surgit l’idée d’un étalon, cette fois-ci en bitcoin. Automatiquement vient le besoin de créer des réserves, comme on le faisait – et on le fait encore – avec des valeurs refuges comme l’or et certaines monnaies traditionnelles. Le parallèle avec l’étalon-or est effectivement intéressant. Comme le souligne Weber (2016), autant l’étalon-or que le bitcoin peuvent œuvrer sans la présence des banques centrales et autorités monétaires. Par contre, si l’or exige une production qui fait évoluer le stock mondial, dans le cas du bitcoin, un algorithme sert plutôt à régir l’arrivée de nouveaux jetons. Ce dernier point s’avère important, dans la mesure où l’arbitrage entre les pays au sujet de l’or entraîne des coûts et, par surcroît, il est difficile de prédire l’avenir des fluctuations du stock d’or, y compris la découverte de nouveaux gisements. Or, le bitcoin profite d’un algorithme qui statue d’avance le nombre limite de jetons à créer, alors que l’instantanéité des calculs rend les frais d’arbitrage quasi nuls – automatiquement, les taux de change entre les monnaies fiduciaires des pays seraient fixés au pair. Malgré tout, Weber prétend à des crises financières avec l’étalon-bitcoin, comme il y en a eu avec l’étalon-or. Parce que la compensation, qu’elle soit équivalente en or ou en monnaie, n’est jamais complètement symétrique. Et qui dit qu’il n’y aura pas en plus manipulation ! Sur la question de la stabilité ou de la durabilité de l’étalon-bitcoin, Weber (2016, pp. 21-22) revient avec les éventualités d’incertitudes économiques et de crises financières : « Un ralentissement cyclique majeur ou une crise financière entraînerait des pressions politiques et des demandes pour que les banques centrales lèvent les “entraves Bitcoin” qui les empêchent d’augmenter la circulation monétaire pour stimuler l’économie ou d’apporter une aide massive aux institutions financières en difficulté [comme ce qui a été nécessaire suite à la crise de 2008]. Les banques centrales ou les gouvernements finiraient par céder à cette pression et rompre le lien entre leurs monnaies et le Bitcoin, tout comme l’ont fait les banques centrales et les gouvernements lorsqu’ils ont abandonné l’étalon-or avant et pendant la Grande Dépression[9] ». Apparaît aussi l’avenue d’une perte d’intérêt et d’usage du bitcoin. Face à une compétition entre les cryptomonnaies, l’une d’entre elles pourraient le remplacer, parce que jugée comme possédant des attributs plus appropriés afin de garantir des prix plus stables ou une inflation modérée (Weber, 2016). Rien n’empêche non plus la proposition par les banques centrales d’une monnaie fiduciaire « utile » pour concurrencer le bitcoin ; « utile » dans le sens où celle-ci, selon Weber (2016, p. 23), peut être adossée à du tangible, voire « à des matières premières ou à un panier de matières premières[10] ». Mais est-ce que l’administration Trump est au courant des risques entourant leur usage ? ou plutôt pourquoi voudrait-elle les prendre en toute connaissance de cause ?
Trump, son administration et les cryptomonnaies
Quelques jours avant son investiture lui accordant un second mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump avait mis en vente sa « meme coin », c’est-à-dire, en le traduisant de cette façon, un mème en cryptomonnaie, voire un type le plus souvent utilisé pour les escroqueries. Dans le but de mieux définir la notion, le mème en cryptomonnaie représente un contenu ou un actif sans valeur, mais qui en obtient une en raison de la popularité manifestée dans son partage entre plusieurs personnes (Morrow, 2025, 21 janvier). Dans le cas du président étasunien, il est question du mème $TRUMP, y compris celui de son épouse $MELANIA ; à cela s’ajoute la possession par la famille Trump d’une plateforme appelée World Liberty Financial qui émet un stablecoin nommé USD1 (Morrow, 2025, 20 mai). Pour offrir des protections aux investisseurs, le site de $TRUMP informe de l’impossibilité de sorties hâtives, de façon à préférer le respect d’un calendrier de déblocage basé sur trois ans. À noter qu’en janvier 2025, le marché des cryptomonnaies possédait une valeur de 3,5 trillions de dollars US, offrant en plus une facilité à qui le veut bien de lancer son propre mème (Morrow, 2025, 21 janvier). On en revient donc aux risques associés à la volatilité des cryptomonnaies, y compris à la difficulté de différencier celles honnêtes de celles frauduleuses. Cela est d’autant plus vrai que l’attrait à ce marché à des fins d’enrichissement est grand. Par exemple, le $TRUMP, géré par la Trump Organization, a empoché en une seule journée environ 58 millions de dollars US en frais de transaction et sans rien n’avoir vendu (Morrow, 2025, 21 janvier). Voilà l’intérêt de la chose : un enrichissement rapide et facile.
En mars de la même année, le président étasunien annonça la création d’une réserve stratégique de bitcoins et d’un stock d’autres actifs numériques par décret, qui seraient administrés par un bureau mis sur pied par le département du Trésor à cet effet (Maruf & Morrow, 2025, 6 mars). Cette réserve serait constituée à partir des bitcoins confisqués par le gouvernement des États-Unis, en vertu de procédures civiles et pénales sur la confiscation d’actifs de gens fautifs. Selon le responsable de l’IA et des cryptomonnaies à la Maison-Blanche, David Sacks, l’avantage de la réserve tient compte d’une offre de bitcoin fixe, limitant ainsi l’imprévisibilité, à savoir un avantage que nous avons cité auparavant et en lien avec l’étude de Weber (Maruf & Morrow, 2025, 6 mars). Or, on accuse Sacks d’être en conflit d’intérêts, puisqu’étant cofondateur de Craft Venture, une compagnie de technologie et d’investissement, dont en cryptomonnaies. Si la logique donne raison d’avoir à la Maison-Blanche quelqu’un qui s’y connaît en matière de technologie numérique, est-ce convenable pour cette personne de détenir des investissements ou même d’être propriétaire d’une entreprise issue du domaine qui concerne ses fonctions gouvernementales ? Voilà la question éthique.
Outre Sacks et bien sûr le président Trump, d’autres membres de l’administration étasunienne actuelle possèdent également des intérêts dans les cryptomonnaies, ce qui laisse sous-entendre un argument autre que celui d’un filet de sécurité pour le gouvernement par la création d’une réserve stratégique. En effet, le secrétaire du Commerce, Howard Lutnick, a démontré rapidement son enthousiasme au projet du président d’adopter les cryptomonnaies. D’ailleurs, parmi les détenteurs actuels figure Cantor Fitzgerald, une société d’investissement étasunienne spécialisée dans le courtage, qui a été dirigée par Lutnick pendant plusieurs décennies avant de passer les rênes à son fils de 27 ans (Morrow, 2025, 13 mars). Pour être encore plus précis, Cantor Fitzgerald représente le principal partenaire de Tether, un émetteur de l’une des cryptomonnaies les plus négociées, et a acquis une participation évaluée à 1,58 milliard de dollars US dans MicroStrategy, à savoir le plus grand détenteur de bitcoins du monde (Morrow, 2025, 13 mars). À Lutnick s’ajoutent notamment le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, et la directrice du Renseignement national, Tulsi Gaddard, détenant des investissements en cryptomonnaie (Morrow, 2025, 13 mars). Ces derniers se sont engagés à liquider 1 million de dollar US de leur avoir.
Conflit d’intérêts et corruption semblent apparaître dans le portrait. Et avec Trump au pouvoir, même la SEC (Securities and Exchange Commission) a dû reculer dans son intention de réguler les cryptomonnaies (Morrow, 2025, 13 mars). En plus, le président de JPMorgan, Jamie Dimon, a changé de ton sur le sujet, lui qui pourtant dans une audition au sénat étasunien en 2023 disait s’opposer farouchement au bitcoin et aux autres cryptomonnaies, dont il considérait leur utilité seulement pour « la criminalité, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale[11] » (Sigalos & Son, 2025, 19 mai). L’administration Trump poursuit donc dans son orientation, alors qu’un important projet de loi visant à soutenir l’industrie des cryptomonnaies est en marche ; il porte le nom de GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation), afin de favoriser les « stablecoins[12] », voire des cryptomonnaies stables (Morrow, 2025, 20 mai). Si les démocrates ont d’abord refusé d’appuyer le projet de loi, en raison surtout des manœuvres du président Trump agissant en dehors du cadre établi, entre autres celle d’organiser un dîner privé entre les principaux détenteurs du $TRUMP, sans oublier l’épisode du jet luxueux offert par le Qatar qui met en jeu les entreprises familiales en cryptomonnaie du président étasunien[13], à savoir des risques d’influence sur la législation à des fins personnelles, une volte-face s’est produite ensuite (Morrow, 2025, 20 mai). Pourquoi ? Parce que le secteur des cryptomonnaies a injecté des millions de dollars US lors de la dernière campagne, autant pour le compte des démocrates que celui des républicains et, de toute façon, la technologie blockchain est là pour durer – on ne peut donc rebrousser chemin.
Rappelons-nous aussi la présence de grands noms du web à la Maison-Blanche, lors du retour de Trump à la présidence. Amazon, Google et Meta[14] ont d’ailleurs un intérêt dans les cryptomonnaies et selon Hilary Allen, professeure de droit à l’American University, le projet de loi permettrait aux grandes plateformes numériques de devenir l’« équivalent fonctionnel » (« functional equivalent ») des banques (Morrow, 2025, 20 mai). Il n’y aurait donc presque aucune résistance à l’émission de stablecoins par les géants de la technologie web. L’avantage indéniable des transactions en stablecoin se résume à l’intégrer aux applications et, du coup, à forcer les utilisateur.trice.s à y rester, permettant ainsi de recueillir davantage d’informations sur ces dernier.ière.s et leurs habitudes d’achat (Morrow, 2025, 20 mai). Par conséquent, la plus grande préoccupation de la professeure Allen repose sur ces facteurs susmentionnés, qui lui rappellent la crise de 2008 susceptible donc de se répéter avec la cryptomonnaie et les grandes compagnies du web. Car il est toujours question d’un produit financier, d’un marché également, non exemptés des mouvements de panique. Et le commentaire du vice-président étasunien, J. D. Vance, lors d’une conférence tenue à Las Vegas le 28 mai 2025, n’a rien de rassurant au sujet de l’encadrement de la cryptomonnaie : d’abord, lorsqu’il dit : « Nous comprenons tout le potentiel du secteur des actifs numériques, non seulement en tant qu’investissement, non seulement en tant que technologie de pointe, mais aussi en tant que symbole et vecteur de liberté individuelle pour tous nos citoyens et nous sommes déterminés à concrétiser cette promesse[15] » (CNN News Central, 2025, 28 mai) ; et ensuite : « Peut-être la chose la plus importante que nous ayons faite pour cette communauté est de rejeter les régulateurs et de limoger Gary Gensler [président de la SEC sous l’ère Biden], et nous allons licencier tous ceux comme lui[16] » (Waldenberg & Morrow, 2025, 28 mai). Voilà un discours libertarien, un discours sur une sorte de monétarisme, pour ne pas dire un « cryptomonétarisme », dans un laisser-aller du marché avec donc une faible intervention de l’État.
Or, exagérons-nous la situation sur la base même d’une « cryptophobie », parce qu’il y a eu depuis l’apparition du bitcoin des histoires de fraude et de pertes majeures ? N’est-ce pas aussi ce qui est arrivé jadis avec les monnaies traditionnelles, sujettes aussi à la spéculation, autant que l’or et l’argent en ont subi les effets, au point de provoquer des paniques et des banqueroutes de banques, à savoir des histoires à faire peur ? Tout revient à équilibrer la crainte du risque et l’appât du gain ; autrement dit, à savoir créer un climat de confiance. Chose certaine, un pur laisser-aller des cryptomonnaies semble entrer en contradiction avec l’apaisement des peurs, tandis qu’une régulation excessive n’est pas mieux et risque d’entraîner la perte de leurs avantages. D’une certaine façon, la réflexion se dirige ensuite vers « qui » tentera d’encadrer cette industrie et avec « quelles » intentions. Force est d’admettre que la polarisation politique des États-Unis se répercute dans les discours sur la cryptomonnaie, d’abord, en voyant dans l’administration Trump un allié, ensuite, en voyant dans cette même administration et son président la volonté de satisfaire des intérêts personnels au détriment du bien commun. D’ailleurs, les doutes portés à l’endroit du président étasunien interfèrent dans le traitement de la question beaucoup plus large de la cryptomonnaie, supposant la nécessité d’un effort visant à le tasser un tant soit peu de l’équation, afin de mieux réfléchir – même si cela peut être ardu. Cela dit, la décision de créer une réserve stratégique et d’encourager également les stablecoins, oblige de s’interroger sur le rôle des banques centrales et d’un possible étalon-bitcoin ou autres choses. À la lumière de notre compréhension de l’épisode en cours, l’industrie des cryptomonnaies ainsi que l’administration Trump revendiquent une liberté d’action, en évitant les entraves de la SEC et donc aussi de la banque centrale étasunienne, sur la base d’une compétition entre les cryptomonnaies, dont la victoire de certaines sera considérée à partir d’une stabilité garantie par leur parité avec le dollar US. En d’autres termes, l’étalon recherché ne porte pas sur une virtualité comme le bitcoin, mais sur une monnaie réelle, tangible ; en plus, celle-ci peut être rapportée à une valeur refuge comme l’or, si le besoin se fait sentir. N’est-ce pas là une protection suffisante, diront les partisans des cryptomonnaies et donc forcément des stablecoins ? Mais cette supposition expose cette tendance à vouloir répéter l’histoire, surtout dans les moments d’hésitation. En effet, l’usage supposé ici de l’étalon-dollar US adossé aux cryptomonnaies ressemble étrangement à l’étalon-or adossé aux monnaies fiduciaires. Et comme Weber (2016) l’a dit, un étalon est susceptible de disparaître un jour, ce qui insinue l’éventualité d’un marché de la cryptomonnaie exempté de son étalon terrestre…
Pour l’instant restons-en à l’hypothèse de l’étalon-dollar US, afin de considérer l’hésitation à vouloir abandonner totalement le système monétaire actuel, ce qui s’avère effectivement justifié : car il faut gagner et conserver la confiance des investisseurs et de la population en général qui s’y intéressera d’ailleurs de plus en plus. Reste le ménage à faire dans les centaines – et plus – de cryptomonnaies en circulation, en incluant bien sûr les mèmes, d’où un retour forcé vers les considérations éthiques. En reprenant l’exemple du mème $TRUMP, il y a ici renforcement des craintes et des doutes, en dépit du fait que certaines personnes pourraient y voir un consentement ou un appel par le président étasunien à l’adhésion désirable à la cryptomonnaie. Il faut souligner le principal problème : le meme coin est un actif sans valeur à la base, sans utilité ; il gagne et perd en valeur seulement en raison de sa popularité, ce qui revient à l’évaluation sociale de l’image de son émetteur à travers une cotation économique, voire monétaire. Nous voilà dans la pure spéculation et la fantaisie ; il s’agit de donner à quelqu’un le pouvoir de créer quelque chose avec rien, d’où une contradiction fondamentale avec l’esprit économique de la production et de l’échange d’un bien ou d’un service contre une rétribution de la même valeur. Dans le cas présent, on amène des gens à dicter la valeur d’une chose qui n’en a pas. Pourquoi alors poser ce geste pouvant être perçu comme insensé, alors qu’il existe des actifs et d’autres biens et services utiles, voire aussi des monnaies bien établies et également utiles ?
Au-delà de l’explication de « l’attrait de la nouveauté » (Morrow, 2025, 21 janvier), il faut reconnaître l’ambition de vouloir créer son propre marché, d’entraîner d’autres avec soi, dans le but unique de provoquer des surenchères qui peuvent rapporter à celui ou celle qui a su se retirer au bon moment. On se transpose ainsi dans la société des loisirs, des individus et du jeu, le meme coin devenant une occasion de tester sa valeur sociale, pour l’instigateur.trice, et ses talents de spéculateurs, au lieu d’investisseurs, pour les joueur.euse.s aimant la témérité, alors que les règles du jeu sont simplifiées au maximum, c’est-à-dire remporter la plus grosse cagnotte. En vérité, le véritable gagnant est l’émetteur qui engraisse son trésor, grâce aux multiples frais de transaction, en laissant les joueur.euse.s procéder à leurs achats et ventes. Mais est-ce si différent du marché des actions ? Dans ce dernier cas, il existe un cadre et les délits d’initié sont punis. Où est le délit d’initié dans un mème ? À la lumière de ce qui se dessine pour le marché de la cryptomonnaie sous l’administration Trump, les règles limitées tourneraient autour de celles présentées pour le $TRUMP, c’est-à-dire un calendrier de vente pour éviter les sorties trop brusques ; en revanche, une telle cédule peut créer un effet intéressant sur les frais de transaction, dans la mesure où, tout dépendant de la volatilité de la cryptomonnaie, les joueur.euse.s seront tenté.e.s d’acheter ou de vendre à « petits feux », puisque restant attaché.e.s plus longtemps à la plateforme, ils et elles voudront « jouer » plus longtemps, d’où des déboursés plus fréquents en frais de transaction.
Par ailleurs, les gens du monde économique pourraient voir dans les meme coins l’application d’une logique comparable à l’échange de n’importe quel bien ou service, dans le sens où la valeur ne dépendrait pas du coût de production, mais de son attrait : il possède une valeur dès le moment où il est acheté. Cette première opération serait donc à la base de la création de la valeur et de la richesse, selon ce point de vue. Puisqu’il est acheté, il obtient une utilité ; dans ce cas-ci, elle relève, d’une part, de sa capacité à générer une élévation du capital, et d’autre part, de sa capacité à donner le pouvoir d’acheter d’autres biens et services. Par conséquent, il n’y a pas de différence par rapport à l’investissement sur les marchés monétaires conventionnels ou encore dans l’achat de métaux précieux. Or, la cryptomonnaie permet une liberté, c’est-à-dire elle offre cette impression de pouvoir agir en dehors des règles, d’être son propre maître d’œuvre… ; ce qui semble n’avoir aucune valeur – donc le rien du mème –, d’après notre première interprétation, serait une erreur, car, en réalité, la liberté elle-même est évaluée. C’est cet esprit de liberté sur lequel le vice-président étasunien capitalise d’ailleurs. La question éthique et morale doit alors reposer plutôt sur cet aphorisme nécessaire de rappeler en contexte sociétal, c’est-à-dire sur le respect d’autrui, puisque la liberté de l’un commence là où celle de l’autre arrête. Bien entendu, avec le mème $TRUMP, le président étasunien s’enrichit, et ce, parce que certaines personnes ont choisi d’investir de la sorte. Devons-nous les leur interdire ? Non. Par contre, comment les protéger des actes frauduleux, donc contraignants à leur droit de liberté ? Une réponse facile serait de leur imposer la faute dès le départ, car malgré les risques évidents elles ont tout de même choisi ce mode d’investissement. Mais ont-elles réellement agi en toute connaissance de cause ? ont-elles été bien renseignées ? S’il existe des balises, des règles, c’est en raison d’un choix collectif d’assurer une stabilité et une confiance. Dans ce cas, la question éthique à poser devrait-être la suivante : quels comportements doivent être admis, autant par les émetteurs que les investisseurs, afin d’assurer le bon fonctionnement et l’essor des cryptomonnaies ?
À vrai dire, la principale préoccupation semble davantage concerner le fait de posséder des actifs en cryptomonnaies par des personnes occupant des fonctions importantes au sein d’un gouvernement – il faudrait aussi ajouter la propriété de plateformes d’échange. Si tout le monde avait en réserve de la cryptomonnaie, comme aujourd’hui nous avons de l’argent dans nos comptes bancaires, les craintes seraient alors infondées. Pourtant ce genre de question ne semblait pas affecter les époques passées, avec leurs banquiers qui faisaient la pluie et le beau temps. La différence majeure repose sur les époques elles-mêmes ; les marchés sont différents, puisqu’aujourd’hui les échanges se font à l’intérieur de marchés immenses et interdépendants, et ce en fonction d’un système qui s’est rodé avec le temps lui-même. S’ajoute désormais la particularité du marché virtuel qui pénètre dans celui réel. Il n’empêche que les soubresauts vécus en raison des cryptomonnaies permettent de faire ce parallèle des débuts, où l’histoire nous invite à éviter les erreurs à ne point répéter. Or, si la tendance autrefois consistait à voir des bourgeois et des chefs d’entreprises supporter des candidats aux élections, désormais on les voit poser eux-mêmes leur candidature. Ce faisant, le portrait politique a changé et, dès lors, apparaît le problème éthique, puisque des politiciens sont appelés à préparer des lois qui auront un impact sur leur domaine d’activités économiques. Si les inciter à se départir de leurs actifs semble être la meilleure solution, on s’aperçoit plutôt de leur transfert dans des fiducies sans droit de regard, ce qui n’élimine point leurs intérêts économiques sur lesquels ils peuvent légiférer. Au final, le meilleur remède consisterait à empêcher les élu.e.s ayant des intérêts dans un secteur d’activités d’œuvrer dans un ministère lui étant rattaché ou même de voter des lois qui pourraient les avantager. Pour dire les choses autrement, le décret du président étasunien en faveur d’une réserve de bitcoins, par exemple, serait « décrété » nul sur la base de ses avoirs et d’un contrôle par association d’une plateforme de cryptomonnaies. Ainsi, la législation sur le sujet devrait relever de la Chambre des représentants, précisément des élu.e.s sans intérêt privilégié. Tout compte fait, la question des cryptomonnaies et du changement de l’image politique des gouvernements démontre la complexité de l’enjeu et oblige à envisager une transformation des pratiques législatives et exécutives.
Conclusion
Comme Adam Smith l’a bien dit, en l’humain habite l’idée préconçue d’une richesse par accumulation d’argent. Qu’il s’agisse du mercantilisme amoureux de l’or ou du monétarisme de la masse monétaire, désormais le monde tangible ne suffit plus aux appétits. Nous voilà tombés dans l’univers des cryptomonnaies, en plus d’un monde politique regroupant à sa tête des ultras riches. Au sein de l’administration Trump, l’accumulation et l’enrichissement demeurent au centre des préoccupations, alors que se présente l’avenue d’une facilité de « faire de l’argent » par l’élimination des barrières physiques et de l’arbitrage, grâce à l’instantanéité permise par des algorithmes de stabilité. Si la ruée vers l’or des XVe, XVIe et XIXe siècles en particulier a créé toutes sortes d’excessivités se transformant en calamités, l’actuelle ruée vers les cryptomonnaies, impliquant en plus des politicien.ne.s, augure-t-elle un scénario similaire ? L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, comme dirait le sociologue allemand Max Weber, encourageaient certes le travail, mais reconnaissaient l’enrichissement que dans la mesure du bien commun. Présentement, un doute subsiste sur les bienfaits communs, puisqu’ils sont plutôt insinués afin d’éviter de mettre au jour des intérêts particuliers. Car l’esprit capitaliste s’est davantage individualisé, au point d’inspirer des visées libertaires. En regardant de près les actions posées par l’administration Trump, nous constatons une symétrie des gestes antérieurs posés par quelques-uns de ses membres influents, dont le président lui-même. Autrement dit, les babines ne suivent pas toujours les bottines, lorsqu’il est question du bien commun. Ainsi, le rassemblement des ultras riches auprès de la Maison-Blanche évoque plutôt la solidification d’une oligarchie, pour ne pas dire d’une ploutocratie, qui fait se renfrogner la démocratie étasunienne. Le nouveau monde promis par le cyberespace et ses cryptomonnaies ne serait peut-être pas aussi « libre » – dans le sens démocratique – que nous pourrions le croire. Dans ce cas, pouvons-nous avoir confiance ?
Guylain Bernier
Yvan Perrier
12 juin 2025
16h30
Notes
[1] Joseph Rambaud (1909, p. 114) résume le colbertisme comme suit :
Le mercantilisme dont Colbert fut la plus brillante expression et qui allait trouver un partisan convaincu dans le maréchal Vauban, impliquait ainsi la défense d’exporter des métaux précieux, le développement de l’exploitation des mines d’or et d’argent, les obstacles à l’importation des produits étrangers, la protection du commerce d’exportation au moyen de Compagnies, de traités et même de guerres de commerce, le devoir de l’État de susciter, de guider et de soutenir les industries qui pouvaient, en exportant leurs produits, attirer dans le pays l’or et l’argent des autres peuples : en un mot, l’émancipation économique de la nation et l’écrasement systématique des États concurrents.
[2] Si la crise de 1873 a donné un dur coup à l’étalon-argent pour favoriser l’or, d’autres événements antérieurs ont aussi contribué à faire pencher la balance d’un côté plutôt que de l’autre. En effet, les Paniques de 1825 et 1837, avec leurs lots de banqueroute et de chômage, ont forcé une réflexion sur le besoin d’une monnaie solide, afin de développer le libéralisme économique du moment (Polanyi, 1983[1944]). Un seul étalon était nécessaire, sur la base du métal offrant la meilleure valeur, d’où le choix de l’étalon-or.
[3] Si lier la masse monétaire à une matière comme l’or permettait d’éviter l’émission excessive de monnaie fiduciaire – soit la production de monnaie nationale par une banque centrale notamment – qui la ferait déprécier, en contrepartie il fallait maintenir en tout temps une réserve d’or qui aurait cependant pu être utilisée à des fins productives. Autrement dit, cette réserve servait uniquement à garantir la valeur de la monnaie.
[4] Par arbitrage, il s’agit de la circulation d’or d’un pays à l’autre ; par exemple, le passage de l’or d’un pays à faible pouvoir d’achat (où les prix sont plus élevés) vers un pays à fort pouvoir d’achat (où les prix sont bas) (Weber, 2016). Et lors de l’opération, des frais pouvaient être encourus.
[5] Il importe de faire la distinction suivante : la balance des paiements retrace l’ensemble des règlements d’échange entre les pays partenaires – flux des biens, services, revenus, transferts de capitaux –, tandis que la balance commerciale expose le résultat excédentaire ou déficitaire entre les importations et les exportations propre à un pays.
[6] Le Canada a abandonné l’étalon-or en 1929, le Grande-Bretagne et l’Allemagne en 1931, les États-Unis en 1933 et la France en 1936 (Polanyi, 1983[1944], p. 208 ; Weber, 2016, p. 30).
[7] La paternité du terme « monétarisme » revient toutefois à Karl Brunner, économiste suisse, et son collaborateur Allan Meltzer, économiste étasunien (Aftalion & Poncet, 1984, p. 4).
[8] Notamment le Bit Gold créé en 1998 par Nick Szabo, qui fut d’abord un jeu de décryptage pour remporter une récompense, mais dont la difficulté principale impliquait de procéder à une transaction sans passer par une autorité centrale (CryptoVantage, s.d.).
[9] Traduction libre de : « The would be a major cyclical downturn or financial crisis that would lead to political pressure and demands for central banks to remove the “Bitcoin fetters” that prevent them from inflating to stimulate the economy of from providing large amounts of assistance to financial institutions in trouble. Central banks or governments would eventually yield to this pressure and break the ties between their currencies and Bitcoin, just as central banks and governments did when they went off the gold standard before and during the Great Depression » (Weber, 2016, pp. 21-22).
[10] Traduction libre de : « […] by some commodity or basket of commodities » (Weber, 2016, p. 23).
[11] Traduction libre de : « [...] the only true use case for it is criminals, drug traffickers... money laundering, tax avoidance » (Sigalos & Son, 2025, 19 mai).
[12] En effet, le « stablecoin » est une cryptomonnaie conçue pour offrir un prix stable en permanence, c’est-à-dire une stabilité reposant sur le maintien d’une parité (1 pour 1) avec le dollar US, mais cela peut aussi concerner toute autre monnaie traditionnelle stable.
[13] S’ajoute aussi le cas de l’investissement d’une société d’Abu Dhabi, MGX, qui a choisi l’USD1 pour financer 2 milliards de dollars US dans la plateforme Binance. World Liberty Financial, soit la plateforme de la famille Trump, émet le stablecoin justement appelé USD1 (Morrow, 2025, 20 mai).
[14] En 2019, Meta avait d’ailleurs tenté de se lancer dans la cryptomonnaie avec Libra, qui deviendra plus tard Diem, mais avait dû l’abandonner en 2022 en raison de l’opposition gouvernementale et réglementaire (Morrow, 2025, 20 mai).
[15] Traduction libre de : « We understand the full potential of the digital assets industry, not just as an investment, not just as an flashy technology, but as a symbol and driver of personal liberty of all our citizens, and we are dedicated to seeing that promise fulfilled » (CNN News Central, 2025, 28 mai).
[16] Traduction libre de : « Maybe the most important thing we did for this community, we reject regulators and we fired Gary Gensler, and we’re gonna fire everybody like him » (Waldenberg & Morrow, 2025, 28 mai).
Références
Aftalion, F., & Poncet, P. (1984). Le monétarisme (2e éd., mise à jour). Paris, France : Presses Universitaires de France.
CNN News Central. (2025, May 28th). Trump embracing cryptocurrency in second term. CNN Live. Repéré à https://archive.org/details/CNNW_20250528_190000_CNN_News_Central
CryptoVantage. (s.d.). Une brève histoire de la cryptomonnaie. Repéré à https://www.cryptovantage.com/fr/guides/une-breve-histoire-de-la-cryptomonnaie/
Delumeau, J. (1984). La civilisation de la Renaissance. Paris, France : Arthaud.
Fauquier, M. (2018). Une histoire de l’Europe. Aux sources de notre monde. Monaco, Monaco : Éditions du Rocher.
Maruf, R., & Morrow, A. (2025, March 6th). Trump creates a Strategic Bitcoin Reserve one day ahead of White House crypto summit. CNN Business. Repéré à https://www.edition.cnn.com/2025/03/06/business/strategic-bitcoin-reserve-trump/index.html
Marx, K. (1968[1867]). Le Capital. Livre I. Paris, France : Gallimard.
Morrow, A. (2025, January 21st). Trump’s meme coin is a reminder of crypto’s dumbest use case. CNN Business. Repéré à https://www.cnn.com/2025/01/21/investing/meme-coin-trump-crypto-nightcap/index.html
Morrow, A. (2025, March 13th). Top Trump official’s crypto ties raise red flags as the administration touts digital assets. CNN Business. Repéré à https://www.edition.cnn.com/2025/03/13/business/trump-officials-crypto-bitcoin/index.html
Morrow, A. (2025, May 20th). As a major crypto bill advances, skeptics see ‘a slow moving car crash’. CNN Business. Repéré à https://www.cnn.com/2025/05/20/business/crypto-genius-stablecoin-nightcap
Polanyi, K. (1983[1944]). La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps. Paris, France : Gallimard.
Rambaud, J. (1909). Histoire des doctrines économiques (3e éd., revue, mise à jour et augmentée). Paris, France : Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts et du Journal du Palais.
Sigalos, M., & Son, H. (2009, May 19th). JPMorgan CEO Jamie Dimon says the bank will let clients by bitcoin, CNBC. Repéré à https://www.cnbc.com/2025/05/19/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-says-the-bank-will-let-clients-by-bitcoin.html
Smith, A. (2009[1776]). La richesse des nations. Paris, France : Flammarion.
Spector, C. (2003). Le concept de mercantilisme. Revue de Métaphysique et de Morale, (3), 289-309.
Stuckler, D., & Basu, S. (2014). Quand l’austérité tue. Épidémies, dépressions, suicides : l’économie inhumaine. Paris, France : Autrement.
Waldenberg, S., & Morrow, A. (2025, May 28th). Vance casts administration as savior of crypto, calling on bitcoin conference to vote in 2026. CNN Politics. Repéré à https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-05-28-25
Weber, W. E. (2016). A Bitcoin Standard : Lessons from the Gold Standard. Staff Working Paper. Ottawa, ON : Bank of Canada.



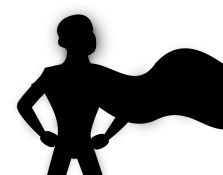

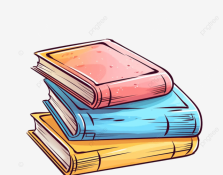







Un message, un commentaire ?