Tout récit a un début. Commençons par celui-ci.
Homo (être humain). Vir (l’homme = mâle). Femina (la femme = femelle). Homo habilis (homme à tout faire). Homo erectus (homme debout). Homo faber (homme ouvrier, qui fabrique ses propres outils et qui développe ses habiletés techniques en vue de maîtriser la nature qui l’environne ). Homo sapiens (homme sage, intelligent et apparemment raisonnable). L’homme moderne. L’humain. L’humain trop humain. L’homme raisonnable et l’homme déraisonnable. Bref, des hommes et des femmes qui sont capables de faire, d’écrire et d’inventer une histoire à leur propre sujet dans un cadre tantôt coopératif et collaboratif, tantôt dans un cadre compétitif et même polémique d’anéantissement réciproque. Des êtres humains différents et opposés, faibles ou forts. DominantEs ou dominéEs. Des personnes humaines capables d’imaginer et de concevoir des choses et leurs contraires. C’est un peu ainsi que doit commencer notre texte sur l’humain idéal / la citoyenne idéale ou le citoyen idéal. Que cache la démarche contradictoire de certainEs grandEs philosophes ou de certains dirigeants politiques qui se sont exercéEs dans l’échafaudage théorique d’un monde parfait, exemplaire ou plus-que-parfait ? Voici, à ce moment-ci, notre réflexion critique sur l’utopie, « (l’)humain idéal » et, bien entendu, ses dérives.
Tout semble démarrer avec Platon, dont la cité idéale impose un être typique qu’il doit contenir. Mais rapidement nous nous apercevons à travers cette première utopie, l’intention de créer de l’ordre dans le désordre, d’exiger une droiture jusque-là, semble-t-il, ignorée par une et des populations. Voilà un programme proposé, pour ne pas dire une éducation, une formation et une structuration destinées à transformer ces personnes en une femme idéale ou un homme idéal. Automatiquement, une dérive survient, alors que ce qui est présenté, comme étant justement « idéal », se métamorphose soudainement en une volonté de puissance, en paraphrasant Nietzsche, menant à conditionner les comportements humains — plutôt les conduites, puisque les gens deviendraient des machines à programmer — vers la voie désirée ; à savoir, une voie pas nécessairement voulue par toutes et tous. Oser riposter insinue des conséquences, des exclusions, voire même des expulsions. Ainsi, l’utopie se transforme en dérive, et là où l’harmonie — sinon l’ordre — règnerait dans le rêve des maîtres-d’oeuvre apparaît plutôt la répression d’une réalité faisant regretter les convertiEs.
Sur les pas de Platon sont apparues au cours de l’histoire des conceptions de l’humain idéal assez particulières. Une tâche ardue serait de parcourir les époques et de retracer les différents types, ce qui exigerait certes de nous étendre sur une longueur que ne permettent pas les conditions d’un article. Par conséquent, le mieux consisterait à nous restreindre à quelques exemples éclairants (essentiellement occidentaux), en ajoutant aux concepts de départ désignés par Platon, celui de l’homme espagnol des XVe et XVIe siècles, pour entrer dans le XXe avec l’homme russe (ou soviétique) et l’homme allemand, sorte de frontière temporelle donnant accès à la période contemporaine avec l’homme « antépersonnel » ou « programmable », en lien notamment avec l’eugénisme et les questionnements moraux qui en découlent. Ainsi, cette brève intrusion dans l’histoire de l’humain idéal révèle encore une fois la justesse de cette maxime : « Plus ça change, plus c’est pareil » ; du moins, du côté des aspirations, car la technologie, elle, change et repousse certaines limites.
Ce que la Cité idéale a besoin
À l’intérieur de sa République, Platon (1993) fait discourir Socrate sur la meilleure Cité, celle qui devrait être recherchée parmi toutes. Si tôt l’allusion entamée, un retournement vise à s’intéresser aux êtres qui se chargeront de la rendre « idéale ». C’est alors que l’idée de la justice, ou de ce qui est juste, s’inscrit à l’intérieur de l’homme recherché qui se doit en plus d’être sage et bon. Mais ces qualités font apparaître des pratiques ou des habitudes, telles que l’excellence de l’âme autant que du corps, c’est-à-dire par l’éducation des sciences utiles, la musique et la gymnastique, le rejet du luxe — cause de la fièvre qui corrompt la Cité —, l’imitation des modèles d’excellence et la piété envers les dieux. Au-delà de ces traits, s’ajoute une structure à respecter, dans la mesure où il ne faut point ignorer les inégalités naturelles entre les humains ; autrement dit, en termes de distinction d’intelligence, de force, de sagesse, de talents divers. À l’intérieur de l’hiérarchie envisagée, voire dans ses stratifications d’humains idéaux, tenant compte du principe selon lequel « chacun doit se limiter à ce pour quoi il est naturellement fait », les gardiens de la Cité devront être les meilleurs, les plus expérimentés, être philosophes ainsi que doux envers les leurs et agressifs contre les ennemis ; les guerriers, pour leur part, seront animés par la virilité, tout en sachant distinguer adroitement ce qui doit être craint de ce qui ne le doit pas ; tandis que les citoyenNEs de la Cité, pour en rester-là, devront être simples et constituer une communauté homogène, mais surtout entretenir un équilibre — autrement dit, éviter les excès, autant dans les jeux de l’âme que du corps.
Si Héraclite prêchait un destin de changement à tout ce qui existe, dans la Cité idéale de Platon, le changement est en quelque sorte proscrit. Tout doit être figé, les pratiques et les règles exigeant d’être préservées, sinon une corruption perverse s’installera. En ce sens, les discours et les expressions artistiques et plus globalement culturelles doivent être encadrés. Cela suppose également de définir ce qui beau et bon d’une certaine façon, d’interdire l’innovation en musique et en gymnastique. En bref, pourquoi apporter des changements si l’objectif ultime de l’idéal ou de la perfection a été atteint ? Autrement dit, les êtres de la Cité idéale accepteront de rester dans cet état jugé ici parfait, parce qu’il serait impossible de trouver mieux ailleurs. Voilà l’utopie !
Par contre, l’humain idéal vivant dans sa Cité idéale n’est pas exclu des réalités naturelles. Comme tout humain, il possède des défauts, tombe malade et meurt un jour. De là s’exposent dans le discours de Platon des mesures pouvant être jugées douteuses, même si on comprend bien leur utilité afin d’atteindre et préserver la perfection de l’environnement désiré. Parce que si la Cité idéale ne doit inclure que des êtres idéaux, cela suppose d’éliminer tout le reste. En ce sens, des oeuvres ne correspondant point à l’image de la beauté prescrite au sein de la Cité devront être détruites et leurs auteurs punis. Les poètes, qui ne respecteront point les exigences, seront alors exclus. Même la médecine sera contrôlée dans son développement, afin d’éviter le traitement des maladies incurables. Et des maux incurables du corps viennent aussi les maux incurables de l’âme tout autant condamnable : ainsi, les criminels, dont les maux de l’âme sont incurables, seront mis à mort, tandis les malades, dont les maux du corps sont incurables, devront être laissés à eux-mêmes et mourir. Une sélection s’enclenche donc et met en parallèle le beau et le bon dans les actes honorables et la santé, en opposition aux actes criminels et à la maladie jugés laids et mauvais.
Déjà ici, l’utopie de l’homme idéal — juste, bon et sage — rend impossible sa relation avec d’autres, moins parfaits, ce qui dévoile toutes sortes de mesures visant à purger une population entière. Une fois accomplie, la République devient idyllique, voire un Éden pour la race humaine, ou prendra plus tard les apparences de l’île d’Utopie (More en 1516), de la Cité du Soleil (Campanella en 1604) ou de la Nouvelle Atlantide (Bacon en 1627) et ainsi de suite. En revanche, l’imperfection imaginée au sein de l’humain suppose tout autant cette incapacité d’atteindre un tel niveau de perfectibilité, au point alors d’envisager des régimes impérialistes d’exclusion, y compris des régimes totalitaires de répression, avec non seulement des mécanismes de règles, mais de véritables institutions faisant du mal un bien.
L’homme espagnol
Suivant la Reconquista (terminée en 1492), l’Espagne connaîtra un épisode faste. En même temps, se développera une conception de l’homme espagnol, comme l’exprime l’historien Bartolomé Bennassar qui y voit « la construction sociologique et culturelle qu’entraîna une construction parallèle, celle de l’Espagne » ; d’où le lien entre l’homme idéal et la Cité ou l’État idéal (Fauquier, 2018, p. 390). Autrement dit viendra l’idée d’élever l’image de l’Espagnol, à travers celle de l’hidalgo (noble), du lettré et du religieux (saint catholique), afin de renverser celle du métissage issu de l’immigration et de conquêtes passées (Fauquier, 2018, p. 390). Sous Charles Ier, la noblesse espagnole se divise entre un degré supérieur (les Grands), les chevaliers, les titrés et, en fin de marche, les hidalguia (ceux qui sont « fils de quelqu’un »). À la religion catholique se joint alors le fondement social, afin de statuer sur l’homme idéal. Mais il s’agit surtout, comme l’avance Michel Fauquier (2018, p. 391), « d’une véritable obsession de la limpieza de sangre (pureté de sang) […] ». En effet, le chrétien de souche est reconnu comme exempt d’hérésie, et ce sur la base non seulement de l’ancienneté, mais d’un attribut — disons divin — conférant à l’individu une pureté de sang. Par conséquent, la population juive et musulmane présente sur le territoire subit une rétrogradation et se voit accoler l’étiquette soit de converso, soit de morisque, sous-entendant une suspicion continuelle d’hypocrisie à leur égard. D’ailleurs, au décret de l’Alhambra (mars 1492), les juifs seront forcés de faire un choix : partir en exil ou se convertir à la religion catholique ; de la même façon, les mudéjares — nom donné aux musulmans restés en Espagne après la conquête chrétienne —, y seront contraints par le décret de février 1502 (Fauquier, 2018, p. 391). Si les juifs avaient déjà été exclus des charges publiques, en plus d’être enfermés dans des ghettos et de porter des signes distinctifs, les mudéjares souffriront à leur tour de la répression.
Une institution d’État apparaîtra d’ailleurs dans l’avènement de l’homme espagnol, c’est-à-dire l’Inquisition. Sous l’autorité des rois de Castille et d’Aragon, l’Inquisition espagnole du début du XVIe siècle entreprendra une purge en s’attaquant aux conversos suspectés de pratiquer en secret le judaïsme, ensuite viendra le tour des « déviants » et des morisques. Fauquier (2018, pp. 395-396) dit sur ce point :
« […] [L]es principales victimes de l’Inquisition furent les conversos suspects d’être restés secrètement attachés au judaïsme : les procès se multiplièrent contre eux jusqu’au début des années 1540 (2 300 à Valence, 7 000 à Tolède, 20 000 à Séville), et manifestèrent une grande sévérité (presque 20 % de peines capitales, une proportion jamais plus atteinte), s’accompagnant de la confiscation des biens des condamnés. L’Inquisition espagnole étant en passe d’en finir avec les juifs, et ayant laissé aux morisques un délai pour se convertir, elle se préoccupa des ‘‘déviants’’, dès la fin des années 1530, avant de se tourner de nouveau contre les morisques qui s’étaient révoltés entre 1568 et 1571 : après s’être concentrés dans le ressort de Grenade jusqu’en 1575, les procès contre les morisques se transportèrent principalement dans les tribunaux de Valence (73 % des causes) et de Saragosse (62 % des causes), avant de s’éteindre du fait du décret d’expulsion prononcé contre les derniers morisques en 1609 ; on revient alors aux déviants, groupe qui fut élargi à l’envi (‘‘luthériens’’, blasphémateurs, ignorants, prêtres indignes, alumbrados [illuminés], sodomites…). »
Face à l’homme espagnol apparaîtront des contre-modèles, tels que le bandido (bandit), le picaro (misérable ou futé) et le gitano (autre marginal se livrant aux trafics) ; si le premier s’associe à d’autres pour former des groupes de briguants, le second vit surtout en ville et tourne en dérision le travail et l’honneur, tandis que le dernier est nomade et on l’accuse de pratiquer les sciences occultes (la divination, la cartomancie, la magie, etc.) (Fauquier, 2018, pp. 399-401). Évidemment, ces contre-modèles doivent être réprimés, d’où de nombreuses expulsions. Mais au final, nous revenons toujours au déterminisme de ce moment historique, alors que cette obsession de l’homme espagnol s’imprègne du caractère religieux servant à la pureté du sang. Cette déviation causera de nouvelles persécutions dans des régimes différents qui instrumentaliseront à leur manière le critère religieux.
L’Homo sovieticus
Si l’homme espagnol s’identifie à une classe de nobles et à la religion catholique, quelques siècles plus tard, en Russie, un mouvement critiquera ces assises, au point de renverser le tsar, d’assujettir le clergé et de prêcher la liberté du prolétariat. À sa manière, la révolution bolchévique expose un renversement de tendance, où les classes supérieures sont détrônées au profit de la classe laborieuse ; autrement dit, le prolétariat — excluant les paysans ou koulaks — constitue le groupe conforme à l’homme soviétique idéal, celui sur lequel il faut compter pour assurer l’essor national. Cependant, l’avènement du communisme soviétique incarnera tout sauf une libération, puisque se manifestera un régime autoritaire, sinon totalitaire, faisant de l’homme idéal un fervent partisan — sujet soumis — du parti. Toute déviance ou opposition sera interprétée comme un signe de sédition — et pourquoi pas d’hérésie — à condamner. Sous Staline, la dékoulakisation ou « liquidation des koulaks en tant que classe », débutée en 1929, entraînera « six millions de morts de faim, plus deux millions de déportés, dont plusieurs centaines de milliers mourront » (Fauquier, 2018, p. 662). Ces « ennemis de classe » seront accompagnés par « les ‘‘éléments socialement dangereux ou socialement étrangers’’ à partir de 1933, puis de celui des ‘‘punis pour collaboration avec l’occupant nazi’’ en 1941 » (Fauquier, 2018, p. 665). Il s’agit de purges massives, dont celles de 1937 et 1938 mèneront à l’arrestation de 1,5 millions de personnes, dont 680 000 seront exécutées.
Il existe alors une phobie de l’étranger, après s’être occupé des koulaks. En 1933, l’État soviétique procédera à une politique de « passeportisation », visant à ficher la population entière (Fauquier, 2018, p. 666). S’ajouteront des déportations, en lien avec « les premières opérations de ‘‘purification ethnique frontalière’’ [en 1937, 180 000 Coréens de la région de Vladivostok seront déportés en Ouzbékistan et au Kazakhstan] » (Fauquier, 2018, p. 666). Avec le pacte germano-soviétique de 1939, le système répressif se développera de façon à assurer l’hégémonie de l’URSS sur une partie de l’Europe de l’Est — notamment les Pays baltes, la Biélorussie et l’Ukraine —, dont la population slave subira une « soviétisation » ; car l’Homo sovieticus est appelé à s’étendre. Par ailleurs, si le régime a encouragé la déportation massive des minorités étrangères de son territoire, l’institution de la répression permettra la création du goulag, visant à punir les déviants des industries, les voleurs et autres ennemis apparus de l’intérieur. Cette orientation politico-sociale possède en elle-même une vocation économique, puisqu’inspiré du marxisme et de sa quête d’une libération des conditions d’exploitation capitaliste — et aussi impériale — de la classe ouvrière. Même si l’allusion à la prédominance du sang d’origine semble être moins apparente ici, elle le sera plus clairement dans le régime du national-socialisme allemand.
La race supérieure
Chose certaine, le régime communiste soviétique aspirait à forger un nouvel homme incarnant ses idéaux, et cette propension sera aussi suivie par le national-socialisme allemand, alors que la répression de l’ennemi racial prend une forme singulière. Comme l’Armée rouge en URSS oppressant les « ennemis de classe », les SA —Sturmabteilungen, voire Sections d’assaut — multiplieront en Allemagne les exactions contre les Juifs dès 1933 : « Celles-ci furent présentées comme une réponse aux campagnes de presse étrangères, en particulier états-uniennes, qui appelaient au boycott des produits allemands pour obliger le gouvernement à changer de politique envers les Juifs » (Fauquier, 2018, p. 678). La même année, un décret servira à les expulser de la fonction publique allemande, tandis qu’une loi interdira le mariage d’un fonctionnaire avec une personne juive, puis une autre mesure à limiter leur nombre à l’école et à l’université. Comme le souligne Fauquier (2018, p. 678), ce mouvement de départ orchestré par le gouvernement aura une suite conséquente d’actions privées, c’est-à-dire la fermeture « d’un nombre croissant de lieux » aux Juifs (hôtels, cinémas, piscines, etc.).
Des similitudes apparaissent ici avec la répression ayant servi à la création de l’homme espagnol. En effet, contrairement au communisme soviétique, où d’autres critères que la confession religieuse entrent en ligne de compte pour désigner l’étranger ou l’ennemi intérieur — en songeant au koulak —, le national-socialisme semble revenir au critère de la religion, mais en s’attaquant spécifiquement à l’une d’entre elles. Il existe une obsession envers le juif — et Juif. Mais il faut y voir davantage qu’une répugnance au judaïsme, afin d’envisager l’élaboration d’une idéologie visant à le démoniser dans toutes les facettes de son existence ; il incarne donc pour le régime le contre-modèle ou l’anti-homme idéal allemand. Cette haine manifeste prend de l’ampleur au fur et à mesure de la montée du national-socialisme, jusqu’à son apogée avec la prise des rênes du pouvoir. Ainsi, les lois élaborées, à partir de différentes thèses ou théories, telles que celle du philosophe et économiste Karl Eugen Dühring (Kursus der National und Sozialokönomie [voir Cours d’économie politique et sociale], 1873) et du romancier Arthur Dinter (Die Sünde wider das Blut [voire Le péché contre le sang], 1917), accentueront l’étendue des purges juives. D’ailleurs, les lois de Nuremberg (1935) serviront à distinguer les Staatsburger (citoyens d’État ou de sang allemand) des Staatsgenhörige (sujets de l’État), alors que les Juifs seront déclassés dans la seconde catégorie et se verront obligés de porter un signe distinctif (Fauquier, 2018, p. 679). De par ce fait, les mariages et relations extraconjugales avec les « citoyens de sang allemand » — au-delà donc des fonctionnaires —, y compris l’emploi de domestiques allemands, leur seront interdits.
Or, une difficulté se présente, dans la mesure où l’Allemagne abrite des gens qui sont à la fois juifs et de sang allemand. Quoi faire dans ces cas ? Hitler proposera une solution classant cette population métisse en deux degrés : d’abord, le premier degré tient compte de la définition du « demi-juif » ou « quart de juif » à partir des grands-parents, alors que l’union de cet individu jugé métis avec un citoyen de sang allemand peut donner un Allemand ; ensuite, le second degré implique un jugement porté sur les habitudes quotidiennes, ainsi est déclaré Juif ou métis de second degré quelqu’un qui pratique le judaïsme, se marie à la synagogue et professe des opinions déviantes sur le régime, alors que, dans le cas contraire, l’individu est déclaré allemand (Fauquier, 2018, p. 679). Par ailleurs, cette distinction entre sang pur, métis et étranger prend sa source dans une tentative de reconstitution de la race aryenne, à savoir une idéologie vantant une race supérieure dont les Allemands sont des descendants directs, avec un homme idéal intelligent, fort, grand, blond et aux yeux bleus. Cette race supérieure subit alors une contamination par la présence d’étrangers, ce qui oblige des mesures d’épuration, comme celles déjà décrites et ayant touché particulièrement la population juive du pays. À ces gestes de répression s’en ajouteront d’autres entre 1935 et 1938, notamment l’interdiction de certains métiers aux Juifs (artisan, libraire, pharmacien, marchand d’oeufs — car la coquille poreuse peut laisser passer des germes —, avocat, médecin), en plus de les exclure des activités boursières et commerciales (Fauquier, 2018, pp. 679-680). Puis viendra la Reichskristallnacht (Nuit de Cristal de l’État) entre le 9 et 10 novembre 1938, moment au cours duquel les SA et SS (Schutzstaffel, voire Escadrons de protection) s’attaqueront à la communauté juive, « brûlant synagogues et locaux, avant de procéder à des arrestations massives frappant les Juifs de 16 à 60 ans, envoyés en camp de concentration » (Fauquier, 2018, p. 680). En bref, le Juif ne peut plus exister en Allemagne ; toutes ces mesures visant à le chasser.
Par contre, comme le souligne Fauquier (2018), en se référant à l’analyse d’Alain Besançon — dans Le malheur du siècle, 1998 —, les Juifs ont été effectivement les principales victimes de la répression nazie, en raison de leur nombre supérieur, mais ils n’ont pas été les seuls. Car l’objectif demeurait la restauration de la race supérieure, de l’homme idéal allemand, dans une phase étendue de purification, alors qu’aux Juifs se sont greffé d’autres cibles, c’est-à-dire les déviants politiques (notamment communistes et toutes les personnes faisant entrave au régime), les déviants religieux autres que ceux appartenant au judaïsme (dont les témoins de Jéhovah, même des militants chrétiens et des membres du clergé s’opposant au national-socialisme et à sa quête), les déviants sexuels (homosexuels) ainsi que les déviants de la race (Roms, Slaves, incluant bien sûr les Juifs). Reste aussi à considérer d’autres groupes menaçant la race aryenne, c’est-à-dire les personnes lourdement handicapées ou souffrant d’une maladie mentale profonde. Face au risque de dégénérescence de la race, la première étape aura consisté à stériliser les femmes atteintes d’handicaps profonds — environ 400 000 suite au décret du 14 juillet 1933, « au nom d’un humanisme inversé qui voulait… éviter ‘‘la naissance de malheureux’’ » —, la seconde, à mettre de l’avant un programme d’euthanasie suite au décret antidaté du 1er septembre 1939 — donnant droit à l’utilisation de l’Aktion T4, à titre de « moyen de… ‘‘soulager la vie’’ de ceux pour qui elle était censée être un fardeau et auxquels le régime proposait une… ‘‘mort miséricordieuse’’ » (Fauquier, 2018, p. 681). Par ailleurs, les centres d’euthanasie expérimenteront les méthodes qui serviront aux camps d’extermination, mais leur différence reposera sur cette attention particulière, puisque les « cendres étaient envoyées dans des urnes aux familles, accompagnées… de lettres de condoléances ! » (Fauquier, 2018, p. 681).
Suite à la dénonciation de l’Église catholique, par le pape Pie XII et les évêques de Berlin (soit Mgr Konrad comte von Preysing-Lichtenegg-Moss dénonçant en chaire les « meurtres baptisés euthanasie ») et de Münster (à savoir Mgr Clemens August comte von Galen affirmant « on tue intentionnellement »), alors qu’elle en subira les conséquences plus tard (1 100 prêtres et religieux arrêtés et incarcérés), Hitler se verra contraint de reculer. À vrai dire, même si le programme d’euthanasie sera suspendu « officiellement le 24 août 1941 », les opérations se poursuivront tout de même, tandis que celles d’extermination resteront discrètes et seront évoquées dans l’équivoque : « Solution finale » (« Endlösung »), « Traitement spécial », « Évacuation », « Transportation », « Réinstallation » ou « Travail à l’Est » étant les termes employés (Fauquier, 2018, p. 684).
Toutes ces atteintes à l’humanité, au nom de l’homme idéal ou du citoyen de sang pur durant le règne du national-socialisme allemand, auront eu pour effet de créer une dualité chez le « type allemand », comme le décrit Friedrich A. Hayek (2013[1946], p. 158), alors que les qualités lui étant accordées, c’est-à-dire laborieux, discipliné, tenace, consciencieux, respectueux de l’ordre et du devoir, prompt à l’obéissance, courageux et autres attributs allant dans le même sens, se confrontent à un manque de qualités individualistes, en termes « de tolérance et de respect envers d’autres individus, d’une certaine indépendance d’esprit et de la droiture du caractère, de la disposition à défendre ses convictions contre un supérieur », étant alors privé « de ces qualités en apparence insignifiantes, mais importantes en réalité qui facilitent les rapports entre les gens dans une société libre : une certaine gentillesse, le sens de l’humour, la modestie, le respect pour la vie privée et la bonne foi ». Ainsi, vouloir créer l’homme — l’humain — idéal suppose ici de le rendre esclave et démuni en quelque sorte de son libre arbitre. Le respect lui étant accordé provient alors de son statut de membre du groupe et dans ses actes visant à atteindre le but commun. Pour cette raison, son individualité ou ce qu’il est en tant que personne importe peu. Ce que souhaitait réaliser le régime national-socialiste allemand de l’époque, dans sa quête de régénération de la race supérieure, pourrait être interprété comme une quête de docilité ou de programmation des individus biologiquement, politiquement et culturellement approuvés par le régime. Ils devenaient en quelque sorte les élus ou les privilégiés, à qui on demandait de remplir la mission d’assurer non seulement le maintien de la race au sein des frontières nationales, mais de la répandre. Parce que cette quête, chez les instigateurs du régime, devait dépasser les limites de l’Allemagne et de l’Europe. Hayek (2013[1946], p. 151) précise ceci, lorsqu’il est question d’un régime visant la totalité et de la place de l’individu :
« D’abord, c’est souvent un sentiment d’infériorité qui pousse l’individu à s’intégrer dans un groupe, pour pouvoir en tant que membre d’une communauté manifester sa supériorité sur d’autres. Parfois, l’individu cherche à s’identifier avec un groupe pour donner libre cours dans une action collective aux instincts violents qu’il doit refréner à l’intérieur du même groupe. Le titre du livre de R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, exprime une vérité profonde : ‘‘L’homme moderne a de plus en plus tendance à se juger moral simplement parce qu’il satisfait ses vices par l’intermédiaire de groupes toujours plus importants.’’ Le fait d’agir pour le compte d’un groupe semble libérer les hommes de maintes entraves morales qui interviendraient s’ils agissaient d’une façon individuelle, à l’intérieur du groupe. »
Voilà donc un régime totalitaire, alors que les droits et libertés individuels sont remplacés par les règles définissant le cadre dans lequel l’individu doit s’insérer pour profiter de son existence ; un cadre qui encourage l’expression de bas instincts, si et seulement si, ils permettent de réaliser le but entendu. C’est la raison d’État qui domine, qui dicte ce qui est bien et ce qui est mal. Par conséquent, l’individu évoluera dans une société à l’aura également totalitaire, comme le signale Hannah Arendt (2009[1964] — Responsabilité personnelle et régime dictatorial, pp. 72-73) :
« La société totalitaire, distincte du gouvernement totalitaire, est monolithique ; toutes les manifestations publiques, culturelles, artistiques, savantes, et toutes les organisations, les services sociaux, même les sports et les distractions, sont ‘‘coordonnées’’. Il n’y a pas de bureau ni d’emploi ayant une quelconque signification publique, des agences de publicité aux cabinets juridiques, de l’art dramatique au journalisme sportif, des écoles primaires et secondaires aux universités et sociétés savantes, dans lesquels on n’exige pas une acceptation sans équivoque des principes au pouvoir. »
Autrement dit, l’homme idéal décrit ici se réduit à un « homme utile pour le régime ». On revient alors à ce qui a été dit : il en est non seulement utile, mais esclave.
Même si le national-socialisme a été défait, notre monde actuel présente des reliquats d’un totalitarisme survivant. En revanche, la quête de l’humain idéal connaît aussi une évolution qui dépasse cette formule, afin d’envisager une nouvelle existence humaine grâce au développement de l’eugénisme et à la greffe de technologies. Au choix de définir l’être idéal par des philosophes, des rois, des chefs d’État ou des régimes politiques, apparaît une science démiurge prête à écouter les demandes de parents cherchant à éliminer les maladies avant même la naissance de leur enfant ou d’individus souhaitant augmenter leurs capacités cognitives ou physiques, sinon à transformer leur corps. En l’occurrence, l’humain idéal, anciennement réduit à une version universalisable, pourrait désormais s’inscrire dans la pluralité. Par ailleurs, si le critère religieux participait à la nature de l’homme idéal par le passé, désormais il disparaît dans la société individualisée et désenchantée, du moins il dépend de la foi des personnes qui accepteront de déroger des règles naturelles — et divines — pour laisser libre cours à leur désir de transformation.
Eugénisme, technologie et moralité
Songer à l’humain idéal amène un questionnement sur la « juste vie », comme le prétend Jürgen Habermas (2002, p. 9), voire sur la vie qui mérite d’être vécue, dans une réflexion à la fois éthique et esthétique. Ainsi, dans les États néolibéraux, où les droits et libertés individuels ont un poids, les démarches entourant les manipulations génétiques ou l’implantation d’un dispositif technologique visant non seulement à améliorer la qualité de vie, mais aussi à vouloir augmenter certaines capacités, placent la définition de l’humain idéal dans l’historicité contemporaine. À première vue, l’eugénisme du temps présent s’éloigne des formules utilisées pour créer soit l’homme espagnol, soit l’homme soviétique, soit l’homme de sang pur allemand. Car le régime étatique est en lui-même différent, mais retient néanmoins le besoin de sa cohésion et de sa perpétuité. Les institutions de répression du passé, visant à forcer les choses, ont été troquées par une pression sociale différente ainsi qu’une propagande des images et des idées sur la vie idéale, c’est-à-dire une vie de beauté, de jeunesse, de santé et de performance. En définitive, les institutions de la science et du marché prennent le dessus en misant sur la biologie et le paraître, plutôt que d’exercer une répression basée sur des facteurs religieux, raciaux et culturels ; au lieu donc de rassembler et d’éliminer des gens ou de les empêcher de procréer, comme dans le régime national-socialiste allemand, la mesure consiste à intervenir sur chaque individu pour corriger les erreurs, en les laissant venir de leur plein gré.
Ce pouvoir de la science s’inscrit dans la liberté individuelle de choisir. Or, ce choix est-il véritablement libre ou influencé ? La crainte de la maladie, la crainte d’handicaps, la crainte d’être incapable de suivre la cadence, dans une société de la performance et de la productivité, mais aussi dans une société de loisirs et de plaisir, sont quelques éléments qui participent à la définition de l’humain idéal moulé ou standardisé d’après les aspirations du régime en vogue. Plus besoin de forcer des expulsions, puisque l’individu sentira la pression sociale des autres, simplement en se comparant, en regardant autour de lui et en s’autoévaluant. Des modèles lui sont d’ailleurs présentés dans la publicité, voire les images diffusées sur les nombreux écrans qui l’entourent autant chez lui qu’à son travail ou ailleurs. Ainsi, l’esthétique de la vie s’inscrit dans la diffusion de ces images à incorporer. De l’autre côté, la vision éthique de la chose, donc aussi de la morale, place l’individu face à une contrariété : est-ce bien de faire cela ? La manipulation du génome humain ou la transplantation de trucs technologiques de performance servent-elles uniquement l’intérêt des parents, des enfants ou des individus ? Car si nous sommes d’accord avec la vie idéale proposée par les images diffusées et, de surcroît, cette vision de l’humain idéal pour notre société, l’intrusion de quelqu’un d’autre à la source de notre transformation fait-elle en sorte que nous soyons obligés de nous départir de la possession exclusive de notre corps, puis à l’extrême de notre vie ?
En ce sens, Habermas (2002, pp. 77 et 96) évoque une possible perte de l’autonomie personnelle, afin d’envisager une hétérodétermination : d’abord, à la liberté eugénique des parents se dresse la liberté éthique de l’enfant ; ensuite, « [l]es interventions visant une amélioration génétique n’empiètent sur la liberté éthique que dans la mesure où elles soumettent la personne concernée aux intentions fixées par un tiers, intentions qu’elle rejette, mais qui sont irréversibles et l’empêchent de se comprendre comme l’auteur sans partage de sa vie personnelle ». D’ailleurs, la manipulation et l’implantation deviennent une forme de transaction dans un marché où le profit entre en ligne de compte ; à la fois, l’humain davantage performant et moins malade devient un outil de production fiable, en plus d’être lui-même un produit issu d’une économie rattachée aux réalisations scientifiques. Plus que cela, l’intervention tient compte d’un tiers qui choisit, selon ses préférences, ce que deviendra une autre personne. Mais est-ci si différent du cas où quelqu’un choisit de vivre ou de s’habiller de façon à ressembler à une vedette du cinéma ? Ou de s’afficher à un groupe à la mode particulière ? Qu’il soit question d’une manipulation génétique ou de l’implantation d’un microprocesseur, n’est-ce pas une forme de marque distinctive qui s’apparente au tatouage ? Pour décortiquer l’ensemble, disons que la manipulation génétique qui donnera vie à une personne n’a pas été choisie par elle, contrairement à la décision de se faire greffer un dispositif technologique. Dans ce second cas, l’intention de faire croître ses capacités est-elle entièrement indépendante de l’extérieur ? La réponse est non. Mais est-ce si différent d’une femme qui demande des implants mammaires ou d’un homme qui se fait installer un coeur artificiel ? Que ce soit pour l’estime de soi, le prolongement de la vie ou le besoin de se sentir plus performant, quel en est le mal ? Le mal provient du fait selon lequel un tiers obtiendrait un droit sur la personne qui perdrait son autonomie. Voilà la dimension éthique qui interfère en lien avec les droits et libertés individuels. Pour la même raison, une personne entièrement créée en laboratoire devrait aussi avoir des droits sur cette même base.
Or, ce dernier point lève le voile sur une éventualité : l’élevage d’humains, voire même le pouvoir de disposer de la nature humaine au gré de préférences. Dans ce cas, un tiers s’accapare l’autonomie des individus, au point même d’anticiper la création d’une société idéale par des dirigeantEs se donnant l’autorité de le faire. En s’appuyant sur cette hypothèse dangereuse, l’eugénisme et la programmation humaine serviraient les causes d’un État totalitaire. De là apparaît un lien avec le biopouvoir de Michel Foucault (1976), inséré dans un système permettant de réguler les niveaux de population, mais aussi d’exercer le pouvoir de vie et de mort, d’après toutefois une formule distincte des XIXe et XXe siècles. Car ce biopouvoir a servi à développer le capitalisme, en plaçant les corps dans la machine à production, mais aussi dans les institutions de formation ou de réforme — comme la prison — ainsi que dans la structure hiérarchique de la société servant cette fin. Désormais, les moyens eugéniques et technologiques pourraient servir à éliminer non seulement les maladies et les handicaps, mais les déviances, grâce à l’avènement de l’humain programmé pour la société idéale.
American Great Again
Aux États-Unis, le second mandat de Donald Trump se caractérise par une habitude des décrets et des répressions qui donne une impression de déjà-vu. L’expulsion des sans-papiers peut être seulement la pointe de l’iceberg d’un mouvement de répression pour tous groupes de déviants. De la même façon, contrôler les messages et le savoir scientifique insinue une propagande destinée à un but précis. D’ailleurs, le slogan de campagne identifiant le besoin de ramener la grandeur états-unienne peut aussi évoquer un retour de l’homme états-unien « idéal », un homme ressemblant au Capitain America, c’est-à-dire, grand, fort, blond et aux yeux bleus… D’ailleurs, le monde économique d’aujourd’hui, capable de fournir des modèles du paraître, offre à toutes et tous la possibilité de changer la couleur de l’iris (par des lentilles cornéennes), des cheveux (par la teinture), de la peau (par des crèmes diverses ou des techniques de blanchiment), de gagner en force (par des séances d’exercice, des suppléments, des vitamines ou autres choses) et d’être plus grand… (par des chaussures à semelles épaisses ?). Mais il s’agit de simulacres qui ne comblent point les attentes de l’humain idéal, puisqu’il ne l’est pas seulement en apparence : au-delà du physique, il doit posséder une mentalité convergente. À nouveau ici, cette image revient aux préférences de l’administration Trump, comme dans les régimes du passé où l’humain idéal se confondait aux aspirations des dirigeantEs. D’où l’importance de contrôler le message, de procéder à l’expulsion des groupes déviants ou contribuant à ternir l’image voulue (groupe LGBTQ+ et autres, immigrantEs haïtienNEs, sans-papiers, en plus des personnes identifiées criminelles, dangereuses et propagatrices de subversions), de mener alors une vaste campagne de purge, aux dires des partisanEs de cette forme d’utopie. Sinon à les rassembler — concentrer — dans des lieux, comme Guantanamo et prochainement Alcatraz, dans l’attente de peut-être faire pire.
Synthèse : Du trop amour de soi à la haine des autres comme fondement à l’humain idéal
Si Platon a eu toutes les bonnes intentions du monde de développer sa Cité idéale, il a aussi mis en lumière les déviances possibles à cette quête, comme l’ont démontré diverses tentatives ultérieures visant à définir l’humain idéal qui devait l’habiter. Chaque époque s’inscrit dans un contexte et donc une historicité caractéristique. Ainsi, la purge religieuse s’est transformée en une autre de classes ou raciale, alors que les étrangers, plutôt jugés de sang impur, devaient être expulsés. Et souvent les populations laissent agir le régime. Cela se justifierait d’après cette inclination humaine, semble-t-il, à approuver les programmes cherchant à effacer de la vue certaines situations montées en problème, comme l’avance Hayek (2013[1946], p. 148) :
« Des gens tombent plus facilement d’accord sur un programme négatif — la haine de l’ennemi, l’envie des plus favorisés — que sur des buts positifs ; c’est presque une loi de la nature humaine. L’élément essentiel de tout credo politique, capable de sceller solidement l’union d’un groupe, est l’opposition entre ‘‘nous’’ et ‘‘eux’’, la lutte commune contre les hommes qui se trouvent en dehors du groupe. La formule est toujours employée pour obtenir non seulement le soutien politique, mais simplement l’obéissance totale des grandes masses. Elle a l’avantage de laisser une plus grande liberté d’action que n’importe quel programme positif. L’ennemi, qu’on le choisisse à l’intérieur comme le ‘‘Juif’’ ou le ‘‘koulak’’, ou à l’extérieur, est un accessoire indispensable aux chefs totalitaires. »
Ainsi, par un étrange paradoxe, la haine de l’autre servirait au fondement de l’humain idéal… Une haine déformant la réalité et utile à créer un vaste projet de purification de la nation. Mais cette haine de l’autre peut aussi se transformer en une critique portée à l’endroit de soi. Il ne suffit plus d’être soi-même, mais de devenir un Sur-moi, de personnifier un être idéal qui nous aidera à prendre place dans la société ultra compétitive. En parallèle, cette société offre des images devant nous faciliter la tâche. Différents modèles sont présentés, mais toujours revient l’esthétique de la beauté, de la santé, de la performance. Au-delà de l’apparence toutefois, cette quête exige d’avoir une mentalité adéquate, voire approuvée. Cela était vrai chez l’homme espagnol, chez l’Homo sovieticus, chez l’Allemand de sang pur, comme nous pouvons l’entrevoir chez l’American Great Again.
Pour Hannah Arendt, l’humain idéal doit être pensé par soi-même. En revanche, il n’est pas question d’eugénisme, de transformation corporelle ou d’imitation aux images diffusées sur les écrans, bien plutôt d’un état de conscience impliquant la faculté de juger. Car penser et juger ne sont pas la même chose. Si le premier traite surtout de représentations, le second oblige de revenir sur elles et de les catégoriser : sont-elles belles ou laides, justes ou injustes ? Voilà une manifestation de la connaissance qui, selon Arendt (2009[1970] — Pensées et considérations morales, p. 246), « peut empêcher des catastrophes, du moins […], dans les moments cruciaux ».
Conclusion
L’humain n’est pas une personne dépourvue de caractéristiques qui le distinguent des autres espèces animales. C’est un être capable de s’élever au niveau de la pensée. Qui dit pensée dit également connaissance et imagination. Connaissance de la chose et des processus. Imagination de comment cela fonctionne (le monde et les choses dans leurs manifestations empiriques) et de comment cela pourrait fonctionner idéalement (le monde imaginé dans un cadre normatif). La capacité d’imagination de l’humain est débordante et personne jusqu’à maintenant n’a été en mesure d’établir avec précision les limites de celle-ci. Hélas, tout chez les êtres humains n’est pas réparti également. Il en est ainsi pour les habiletés techniques et intellectuelles ; la force et la faiblesse ; la capacité d’orienter ou de subir le changement. L’humain est un être complexe et surtout contradictoire. Il est capable de grandeur, mais aussi de petitesse. Il y a de l’intelligence dans les personnes humaines, mais également de la bêtise. L’humain a conscience et connaissance d’un monde changeant, pouvant changer et qui changera inévitablement. Tantôt pour le mieux. Tantôt pour le pire. Il n’existe a priori aucune limite à l’imagination d’un monde idéal. Par contre, il y a des limites à l’exploitation des ressources de l’environnement et à la technique qui ne parviendra pas à résoudre la totalité des problèmes rattachés à la volonté de certains humains à vouloir se comporter comme « Maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes).
L’humain est un curieux mélange de rationalité et d’irrationalité. Il arrive parfois que le peu de rationalité qu’il recèle ne lui permette pas de domestiquer complètement son irrationalité. Il y a de l’amour, mais aussi de la haine, dans les personnes humaines. L’amour des autres et de soi. La haine des autres, mais aussi la haine de soi. La haine de soi, qui refuse de s’admettre et qui pourrait être le fondement de l’humain idéal…
Guylain Bernier
Yvan Perrier
10 mai 2025
10h30
Références
Arendt, Hannah. 2009[1964-1975]. Responsabilité et jugement. Paris : Payot & Rivages, 362 p.
Fauquier, Michel. 2018. Une histoire de l’Europe. Aux sources du monde. Monaco : Éditions du Rocher, 750 p.
Foucault, Michel. 1976. La volonté de savoir. Dans Histoire de la sexualité (Tome I). Paris : Gallimard, 212 p.
Habermas, Jürgen. 2002. L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ? Paris : Gallimard, 181 p.
Hayek, Friedrich A. 2013[1946]. La route vers la servitude. Paris : Presses Universitaires de France, 260 p.
Platon. 1993. La République. Du régime politique. Paris : Gallimard, 553 p.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :







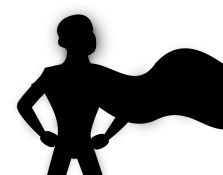

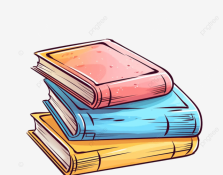



Un message, un commentaire ?