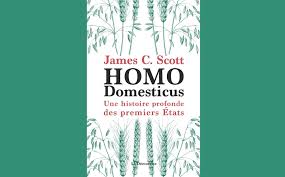
Récit qui mène du chasseur-cueilleur nomade à la domestication des animaux et des plantes, à l’agriculture, à la sédentarité et aux Cités-États (en intégrant au passage l’invention de l’écriture, le commerce, l’art et la science, etc.). Scott démonte le grand récit de la naissance de l’État antique comme étape décisive de la civilisation humaine. Il se demande ce que la sédentarité a bien pu avoir de « désirable ». Le chasseur-cueilleur était mobile, il se nourrissait de ressources variées et faciles d’accès. Il disposait de beaucoup de temps libre et était en meilleure forme que l’agriculteur qui lui, était abîmé par les labours, asservi par les soins à donner à son troupeau et très vulnérable aux épidémies. Dans ce livre, le professeur émérite de science politique et d’anthropologie à l’université Yale se demande pourquoi la culture des céréales a-t-elle été préférée à la polyculture des autres tubercules au rendement rapide et exigeant peu d’efforts (l’igname, le manioc ou la patate douce) ? L’hypothèse qu’il avance à ce sujet est la suivante : les céréales sont plus faciles à contrôler, à tarifer, à stocker et surtout à prélever par l’impôt.
De manière plus précise, Scott se pose la question suivante : la naissance de l’agriculture peut-elle être comprise comme un processus de civilisation ? Il y répond par la négative. Les activités exigeantes et surtout routinières des agriculteurs impliquent de la discipline et surtout une soumission à un travail ordonné et répétitif. Les ressources consommables disponibles sont, dans un tel environnement, moins diversifiées, ce qui a comme effet d’appauvrir le régime alimentaire. La dépendance face au climat s’accroit. Scott considère que la sédentarité et l’agriculture sont deux phénomènes qui ont rendu possible l’émergence de l’État. En Basse-Mésopotamie, les villages néolithiques autonomes se maintiennent durant environ deux millénaires. L’apparition d’une sécheresse, entre 3500 et 2500, avant notre ère a pour effet de provoquer une concentration accrue et une réduction des populations. L’État apparaît, en échange d’un contrôle des richesses par le biais de l’impôt sur les céréales, comme l’institution sociale susceptible d’assurer aide et protection à une population vulnérable. C’est en raison de leur visibilité, de leur divisibilité, de la possibilité de les stocker et de les transporter que les céréales se révèlent comme une source intéressante de revenu pour l’État. D’où le concept d’État-céréalier. Aucune autre plante ne présente toutes ces caractéristiques qui en font une source de richesse fiscale incomparable pour l’État. L’État n’est donc pas posé par Scott en tant qu’appareil créé pour être au service de la population. Il s’agit plutôt d’une institution qui sert à mettre au travail le plus grand nombre d’individus. Pendant ses deux premiers millénaires d’existence d’ailleurs, en Basse-Mésopotamie, l’État a mené des guerres non pas pour faire des conquêtes territoriales, mais bien plutôt pour soumettre à son autorité de nouvelles populations ou pour empêcher les anciennes sous son contrôle de fuir.
La grande question qui traverse cet ouvrage est, pour l’essentiel, la suivante : qui domestique qui ? Est-ce l’homme qui a domestiqué la nature et les animaux ou l’inverse ? En asservissant la nature, les animaux et ses semblables, Scott émet l’hypothèse que l’humain a plutôt consenti et fabriqué sa propre servitude. En parallèle et au cœur de l’Homo domesticus on retrouve donc les « barbares » et les « sauvages » (sic) qui ont coexisté avec les « civilisés ». Il y a eu entre ces regroupements humains des razzias, des conflits destructeurs et aussi des échanges commerciaux. L’âge d’or des barbares et des nomades (qui ont également servi d’esclaves ou de mercenaires aux civilisés) se clôt avec les débuts de l’État-nation au XVIIe siècle.
Ce livre est incontestablement une très intéressante synthèse historique qui porte sur la naissance des premières formes étatiques que Scott nous présente comme ayant surgi dans la ville d’Uruk en Mésopotamie. L’auteur interroge, dans le cadre d’une démarche critique et dans un style d’écriture claire et bien ciselée, le récit civilisationnel classique. Scott défend le point de vue ici des populations « non étatiques ». Dans l’introduction de son ouvrage, il mentionne que si l’État nous apparaît historiquement comme une forme stable, c’est avant tout parce que cette institution a laissé le plus de traces archéologiques. Il précise à ce sujet : « Malgré la puissance et la centralité dont l’affublent la plupart des récits traditionnels, il faut bien reconnaître que pendant les milliers d’années qui ont suivi son apparition initiale, l’État n’a pas été une constante mais une variable – et une variable assez mineure dans l’existence d’une bonne partie de l’humanité. » (p. 32). Scott pose l’État, dès son apparition, comme un phénomène aux assises fragiles, susceptible de disparaître après quelques générations. Ce sont d’ailleurs les révoltes et les maladies qui sont venus à bout des premiers États que Scott qualifie « d’États archaïques ».
Ce livre s’inscrit dans le courant de l’anthropologie anarchiste américaine. Il nous présente l’État comme étant une construction sociale et historique qui repose à l’origine sur l’exploitation du couple « céréales/main d’œuvre ». Ces premières formes étatiques ont certes été à l’origine de brillantes civilisations, mais à un coût humain exorbitant. Les peuples « sans État » (peuples qualifiés de « barbares ») ont été en mesure d’utiliser de façon plus durable les ressources qu’ils cueillaient et chassaient, tout en conservant une grande part de liberté dans leurs déplacements, échappant par le fait même à l’entreprise de domestication et de servitude dont ont été victimes les éleveurs et les agriculteurs sédentaires.
Homo domesticus est incontestablement une lecture que je qualifierais d’enrichissante et de très stimulante pour les personnes qui se demandent comment il sera possible, un jour, de venir à bout de cette excroissance parasitaire qui est parvenu à s’imposer à la société civile et qui a pour nom l’État.













Un message, un commentaire ?