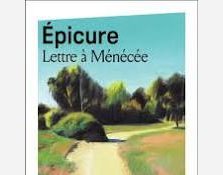Il y a selon moi une exploration qui reste très valable aujourd’hui et c’est celle autour de l’État. Dès les premiers travaux de Marx et par la suite dans la recherche subséquente entamée par les organisations et des intellectuels, l’État a été analysé comme un construit, un évènement historique, un résultat complexe des luttes de classes sur la « longue durée », comme le disait le grand historien Fernand Braudel. Avant l’État moderne, il y a eu des structures étatiques mises en place par divers groupements humains et plus tard, à travers des proto États. Plus souvent qu’autrement, des peuples et des communautés ont résisté à cette mise en place d’un instrument de pouvoir, comme l’explique un autre auteur mal connu (au Québec), l’anthropologue Pierre Clastres.
Au moment de la modernité européenne qui a pris la forme du capitalisme, l’État plus qu’avant a été un outil promu par les dominants dans leur processus d’expropriation, de prédation et de colonisation des peuples. Cet État moderne en fin de compte est né dans un immense bain de sang, celui des paysans irlandais et russes, des esclaves africains et des peuples amérindiens exterminés. Marx fut l’un des premiers à expliquer ce processus plus ou moins occulté, et à s’opposer aux théories « naturalistes » et fantaisistes mises de l’avant par les philosophes des lumières. Adam Smith, le grand-père du capitalisme, disait que l’État « moderne » allait de pair avec le processus économique « naturel » de l’économie de marché. La « main invisible » régulait l’économique dont l’État assurait la « bonne marche », avec des lois et des mécanismes de contrôle qui comprenaient, entre autres, l’obligation pour les pauvres de travailler (empêcher le « vagabondage »), sinon on les mettait en prison. Le philosophe allemand Hegel pour sa part, présentait l’État comme l’apothéose de la modernité, le point culminant où la « rationalité » remplacerait l’anarchie et l’arbitraire. Son modèle reposait sur une vaste bureaucratie « efficace » et « rationnelle », capable de mener la « populace », le « petit peuple » à la baguette.
Pour Marx, toute cette rationalité n’avait de « rationnelle » que celle d’assurer l’accumulation du capital permettant à la bourgeoisie émergente d’éliminer les vestiges de l’ancien système, et surtout, d’empêcher les nouvelles couches populaires de s’organiser et d’imaginer une autre socialité que celle de l’État. Lors de la Commune de Paris, on a vu émerger, sous une forme embryonnaire, un autre système, un anti-État en quelque sorte, basé sur l’autonomie, l’auto-organisation et des structures de démocratie directe. Tous les dominants du monde entier, avec leurs intellectuels de service, ont alors crié au meurtre, comme ils l’ont fait plus tard avec les Soviets, les communes espagnoles, les « caracoles » zapatistes et tant d’autres expériences où le peuple a commencé à prendre les choses en main.
Loin d’être une réalité « naturelle », l’État est en réalité une machine de guerre. Son premier mandat est d’établir les consensus au sein des dominants, qui sont eux-mêmes divisés du fait de leur insertion dans un système capitaliste établi sur la compétition. C’est alors tout un travail intellectuel de déterminer une politique qui assure la protection d’un ensemble diversifié d’intérêts, et où il y a des tendances, souvent diversifiées. Par exemple, des groupes de dominants vont miser à peu près uniquement sur la répression, sous diverses formes d’autoritarisme. D’autres vont estimer qu’il faut user de persuasion, convaincre les dominés, quitte à leur concéder quelques améliorations de la vie, que le système capitaliste est non seulement « naturel », mais qu’il est le meilleur et peut-être même, le seul possible ! L’État est alors le site intellectuel où ce consensus est identifié et négocié.
On voit alors que ce premier mandat de l’État s’imbrique dans un deuxième : assurer le contrôle sur le peuple, le tenir tranquille, le faire intégrer des valeurs d’obéissance et de résignation, insérer dans la conscience populaire le respect de la hiérarchie, du contrôle et du commandement. Alors pour cela, l’État est terriblement efficace. Il y a bien sûr les « appareils d’état » qui organisent cet immense travail via les institutions dont l’éducation, et à travers la société civile, tout en agissant en partenariat avec d’autres structures hiérarchiques (dont la famille et la religion). Tout cet édifice complexe est organisé par l’État. Sans l’État, tout pourrait de disloquer.
Et c’est devant cette réalité que les socialistes sont venus à la conclusion qu’il fallait autre chose que l’État pour permettre l’éclosion d’une véritable émancipation. Si cet objectif a fini par être reconnu par beaucoup de monde, on s’est cependant divisés sur les moyens pour arriver à cette autre société post-État et post-capitaliste. Il y a donc eu de nombreux débats stratégiques, des options contradictoires, voire conflictuelles, et parfois des convergences. Les partisans de Marx ont pensé que l’État capitaliste pouvait en fin de compte être renversé par une action méthodique, progressive, subversive. Les forces anticapitalistes pouvaient « pénétrer » cet État (par exemple les institutions parlementaires, les municipalités) pour en changer le sens, favoriser l’auto-organisation et créer les conditions pour une révolution en profondeur dans les consciences et les esprits, jusqu’à temps que la forteresse du pouvoir ne s’écroule et soit remplacée par un nouvel État « anti-État » qui résulterait de la lente accumulation par les forces de transformation. Au bout de la ligne, l’insurrection, le moment décisif, surviendrait. L’ancien État, affaibli, désorienté, isolé laisserait la place à un nouvel État, quitte à ce que celui-ci ne lui donne d’autre choix que de se dissoudre, comme c’est arrivée en octobre 1917.
Des adversaires de cette optique socialiste ont pensé que toute action dans, à travers et en utilisant le territoire de l’État, était vouée à l’échec, que cela mènerait inévitablement à la cooptation, et qu’il fallait se tenir « loin » de l’État, dans des « communes » autogérées préfigurant cet « anti état » à venir. Ils ont vu venir le terrible retournement du pouvoir soviétique et donc, jusqu’à un certain point, ils avaient raison de se méfier.
Aujourd’hui, le débat n’est pas totalement différent de ces explorations antérieures. La stratégie gramscienne de l’encerclement de l’intérieur et de la guerre de position a été déployée et continue de l’être, par exemple en Bolivie, où une situation ambiguë ressort des insurrections populaires des dernières années. L’État est encore en place, avec ses dispositifs occultes, ses hiérarchies, sa propension à préserver le mal développement (à travers l’extractivisme notamment). En même temps, cet État est dépassé, bousculé par les structures communautaires qui se sont perpétuées et qui sont appuyées par une partie de cet appareil d’État qui a échappé aux mains des dominants depuis l’élection d’Evo Morales en 2006.
Est-ce que cela va fonctionner pour avancer dans l’émancipation ? Il est encore trop tôt pour dire.
À l’opposé, des insurrections qui vont jusqu’au bout, il n’y en pas des tonnes. Il y a plutôt des soulèvements, des grandes mobilisations, mais qui, faute d’une stratégie, n’aboutissent pas à réellement déplacer le pouvoir. Chose certaine, rester « à l’extérieur » de l’État n’est pas une proposition constructive. Il n’y a pas d’ « extérieur », car l’État n’est pas une chose, un bâtiment, voire un gouvernement, mais une structure sociale insérée dans tous les plis de la société. Lutter contre l’État exige donc autre chose que de se réfugier dans un « extérieur » imaginaire, ce que ne semblent pas avoir compris des anarchistes dogmatiques comme Dupuis-Deri.
En attendant, on peut se dire une chose et l’autre. L’État contemporain n’est ni une solution, ni un processus naturel. Dans le cours des luttes et des résistances, les peuples et les communautés aspirent à s’autogouverner, ce qui est non seulement sensé mais possible. Dans cette longue lutte, il y a des « petites » batailles qui ne sont jamais si « petites » que cela. Un groupe de paysans occupe des terres et transforme le site en une coopérative : ce n’est pas rien. Des syndiqué-es font reculer les assauts de l’État et des patrons qui veulent disloquer le collectif ouvrier : c’est toujours cela de pris. Des municipalités sont prises en mains par des coalitions progressistes qui insèrent dans le processus la participation directe (« budget participatif ». Ce sont souvent ces petits pas qui font qu’à un moment donné, l’impossible devient possible.