Né vers l’an 50 après J.-C. à Hiérapolis, en Phrygie (Asie Mineure), Épictète fut emmené à Rome comme esclave. Il a fait partie du groupe des philosophes qui ont été chassés de la capitale de l’Empire par Domitien en 90. Il se réfugie à Nicopolis d’Épire, en Grèce du Nord, où il meurt autour de l’an 135. Son maître, Épaphrodite, un affranchi de Néron, est connu, par la légende, pour avoir infligé de mauvais traitements à son esclave. Il a néanmoins permis à Épictète de suivre l’enseignement du philosophe stoïcien Musonius Rufus (Dégremont, 2014, p. 242 ; Hadot, 1998, p. 517-519 ; Mattei, 1984, p. 860).

Épictète n’a laissé aucun écrit. Son enseignement, fidèle à la tradition socratique, prenait la forme de dialogues et d’apostrophes. C’est l’un de ses disciples, Arrien de Nicomédie, qui consigna ses paroles dans les Entretiens. Pour Épictète, la liberté véritable réside dans la pensée : nul ne peut asservir l’esprit d’un homme libre, même s’il est esclave de corps. Le sage, conscient de ce qui dépend ou non de lui, ne cherche pas à agir sur l’inévitable, mais exerce son esprit à l’accepter avec lucidité et sérénité. Comment tout cela se répercute-il sur le plan de l’engagement politique ? Telle est la question que nous tenterons de résoudre ici à travers la présentation résumée de deux ouvrages qui lui sont attribués : Manuel et « De l’attitude à prendre envers les tyrans » (dans les Entretiens).
Deux caractéristiques majeures du stoïcisme : « Supporter et s’abstenir »
La philosophie d’Épictète s’inscrit dans le courant du stoïcisme, qu’il pousse à un degré de rigueur morale extrême, parfois perçue comme austère et absolument insensible. Indifférent à tout bien extérieur échappant à sa maîtrise, Épictète prône l’acceptation sereine et fière de la nécessité. Sa maxime pratique, « Supporte (ou souffre) et abstiens-toi »[1] (Sustine et abstine), résume l’attitude qu’il recommande face aux vicissitudes de l’existence. Selon lui, seuls relèvent véritablement de notre pouvoir notre raison, notre volonté et, en un sens, notre être intérieur. Les biens matériels ou les événements extérieurs, dépendant du hasard ou de la fortune, doivent, par conséquent, être tenus pour indifférents. Vivre conformément à la raison revient, dès lors, à vivre en harmonie avec la nature. Épictète condamne la passion — qu’il apparente à une sorte de « maladie » de l’âme — car elle détourne l’homme du jugement droit et de la sérénité intérieure. Ainsi, la liberté, le bonheur, la puissance et la perfection ne s’obtiennent qu’au prix de l’impassibilité (apatheia ou l’ataraxie), pour ne pas dire « le détachement des passions » (de Crescenzo, 1999, p. 428) qui constitue le but ultime du sage stoïcien[2].
Épictète : Manuel
Le Manuel d’Épictète est un guide pratique de vie morale, condensant les principes essentiels du stoïcisme pour atteindre la paix intérieure (ataraxie) et la liberté (autarkeia). L’idée centrale de l’ouvrage se retrouve dans la citation suivante : « Ce ne sont pas les choses [ta pragmata ] qui troublent les hommes, mais les évaluations prononcées [ta dogmata] sur les choses » (Épictète - Chapitre V, 2015c, p. 28 et 63)[3]. Le cœur de l’ouvrage repose sur une distinction capitale entre d’une part, ce qui dépend de nous (nos pensées, nos désirs, nos actions, nos jugements) et d’autre part, ce qui ne dépend pas de nous (le corps, la richesse, la réputation, la santé, la mort, les événements extérieurs)[4]. La sagesse consiste à se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous, et à accepter sereinement tout le reste. Les grands principes stoïciens du Manuel[5] sont, pour l’essentiel, les suivants : la maîtrise de soi (ne pas se laisser dominer par les passions, les peurs ou les désirs, cultiver la raison et la modération) ; l’acceptation du destin (tout ce qui arrive fait partie de l’ordre universel : la Nature, la Providence, refuser le destin, c’est souffrir inutilement) ; la liberté intérieure (la véritable liberté ne dépend pas des circonstances, mais de l’attitude intérieure, car, même esclave, un homme peut être libre s’il garde la maîtrise de son esprit) ; le devoir et la vertu (vivre en accord avec la nature et la raison, agir justement, sans attendre de récompense extérieure) ; et finalement l’indifférence aux biens extérieurs (la richesse, la gloire, la santé ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, seul le bon usage qu’on en fait compte) (Hadot, 1998, p. 519-520 ; Mattei ; 1984, p. 863-866).
Parmi certains enseignements célèbres que l’on retrouve dans le Manuel, mentionnons ceux-ci :
« Ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et le cours de ta vie sera heureux » (Épictète. 2015c, ch. VIII, p. 64) [6].
« Rappelle-toi : tu es acteur dans un drame, un drame tel que le veut l’auteur : court, s’il le veut court ; long, s’il le veut long ; s’il veut que tu joues un mendiant, c’est pour que, celui-là aussi, tu le joues avec talent. De même s’il s’agit d’un boiteux, d’un magistrat, d’un simple particulier. Ce qui te revient en effet, c’est de bien jouer le rôle qui t’a été donné ; mais le choisir, c’est l’affaire d’un autre » (Épictète, 2015c, ch. XVII, p. 67) [7].
« Tu peux être invincible, si tu ne descends jamais dans l’arène d’une lutte où il n’est pas à ta portée de vaincre » (Épictète, 2015c, ch. XIX, p. 68).
« Tu peux n’être jamais vaincu, si tu n’entreprends jamais aucun combat où ne dépendent pas absolument de toi de vaincre. » (citée dans la traduction de Dacier, 1971, p. 27).
Le Manuel est pour l’essentiel un guide de conduite (ou des règles de conduites à toujours avoir en tête) et non un traité théorique. Il enseigne comment les stoïciens doivent s’y prendre pour vivre en paix, agir avec raison, et rester libre intérieurement, quelles que soient les épreuves.
Épictète : « De l’attitude à prendre envers les tyrans »
Le texte d’Épictète intitulé « De l’attitude à prendre envers les tyrans » développe une réflexion stoïcienne sur la manière de conserver sa liberté intérieure face à la domination extérieure. Épictète explique que le pouvoir du tyran n’est réel que dans la mesure où on lui accorde de la puissance, autrement dit, où on attache de la valeur à ce qui dépend de lui, comme la richesse, le corps, les honneurs, au lieu de valoriser la liberté intérieure et le contrôle de ses propres représentations et réactions. Selon lui, le tyran affirme souvent être le plus puissant, mais cette puissance est illusoire car elle repose sur des choses extérieures qui ne dépendent pas de nous.
L’enseignement fondamental est que la véritable liberté consiste à se détacher des biens extérieurs et des privilèges que le tyran peut offrir, pour rester maître de son esprit, de ses désirs et aversions. En adoptant cette attitude, on ne peut être opprimé, car la domination véritablement tyrannique ne peut atteindre la sphère intérieure de la liberté et du jugement personnel. C’est ainsi que, par le choix de ce à quoi on attache de la valeur, on peut résister à la tyrannie sans confrontation violente, en refusant de dépendre psychologiquement du tyran.
Pour Épictète, la racine de la servitude n’est nullement dans la force du tyran, mais dans la manière dont chacun valorise ce qui n’est pas dans son pouvoir : honneurs, richesses, intégrité physique, réputation. À partir du moment où l’on accorde à ces biens extérieurs un prix supérieur à la liberté intérieure, on devient vulnérable à la domination externe. De cette analyse, Épictète tire une éthique radicale de l’indifférence vis-à-vis de la puissance extérieure, et ce, peu importe sa nature toutefois. Il invite à distinguer soigneusement, comme nous l’avons déjà dit, entre ce qui dépend de nous (jugement, désir, aversion) et ce qui ne dépend pas de nous (corps, biens matériels, l’opinion d’autrui, actions d’autrui). Seul doit compter l’effort intérieur pour conformer la volonté à la raison et à la nature, en acceptant avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. La leçon centrale devient alors un authentique art de vivre libre au cœur même des pires circonstances politiques ou sociales : l’homme véritablement libre est celui qui se soucie d’abord de maintenir sa souveraineté sur lui-même et considère la perte de tout le reste comme indifférente.
Que penser de cette posture face à la tyrannie ?
Ce texte concerne la liberté de pensée face à l’oppression politique. Le point de vue développée n’incite ni à la révolte violente ni à la soumission, mais à une sorte d’autonomie morale qui relativise radicalement la puissance tyrannique, la ramenant à sa juste mesure : « Zeus m’a permis d’être libre. Ou crois-tu qu’il allait laisser asservir son propre fils ? Tu es le maître de mon cadavre, prends-le » (Épictète. 2015b, p. 106). Autrement dit, « Tu peux me menacer de la mort, mais tu ne disposes pas de ma volonté. » Si l’humanité, note Épictète, était capable de ce discernement, le tyran perdrait immédiatement le ressort de son pouvoir. Le texte fait ainsi du stoïcisme une philosophie de la résistance par l’indépendance d’esprit, versus le culte des biens extérieurs.
Il est permis, selon nous, de reprocher à Épictète de trop faire dans l’indifférence politique[8]. Il prône une attitude trop passive face à l’injustice et à la tyrannie. Il invite à se limiter à la résistance intérieure et au détachement psychologique sans encourager l’action directe ou la lutte politique contre l’oppression. Cette posture correspond à une forme de résignation et/ou de complaisance envers le pouvoir établi : le sage se détourne de la résistance extérieure pour ne cultiver que sa liberté intérieure, au risque d’abandonner la société à la domination du tyran.
La liberté humaine est-elle seulement intérieure et individuelle ? Peut-on la concevoir comme étant complètement détachée des conditions concrètes de l’existence et de la justice sociale ? Épictète est disposé à laisser le champ libre au pouvoir arbitraire du tyran et ce tant que l’individu conserve sa sérénité intérieure. D’un point de vue politique, cette distanciation affirmée face au pouvoir politique[9] conduit à coup sûr à une faiblesse de la résistance collective et à une sous-estimation de la valeur de l’action civique ou de la solidarité. En ramenant toute question politique à une question de représentation subjective et de disposition d’esprit, Épictète semble banaliser la souffrance, l’injustice ou la violence exercée par le tyran. Même s’il fonde une éthique de la souveraineté subjective puissante pour briser l’emprise psychologique de la peur, sa doctrine reste nettement, selon nous, critiquable pour son insuffisance du point de vue de la résistance active, de la justice collective et de la transformation des rapports de pouvoir.
Le point de vue que nous avançons mérite possiblement d’être nuancé, si nous prenons le temps d’examiner ce à quoi correspondait la tyrannie à l’époque de la Grèce antique. La différence de la portée de ce concept avec ce à quoi il correspond aujourd’hui semble majeure.
Au sujet de la différence entre la tyrannie à l’époque de la Grèce antique et aujourd’hui
La différence principale entre un tyran à l’époque de la Grèce antique et aujourd’hui tient à la nature du pouvoir exercé par le tyran et aussi à la perception du mot.
Dans la Grèce antique, le terme « tyran » (τύραννος, turannos) désigne un individu qui s’emparait du pouvoir illégalement, généralement par la force, sans respecter les règles de succession en vigueur. Ce pouvoir - et il importe de le préciser - n’était ni préalablement mal vu ni toujours négatif au départ : certains tyrans ont pu être populaires, notamment lorsqu’ils prenaient le parti du peuple contre l’aristocratie. La tyrannie était alors caractérisée par : la prise de pouvoir illégitime (sans droit héréditaire ou légal reconnu) et un exercice du pouvoir absolu, mais conservant parfois les lois et institutions existantes pour sauver les apparences. Parfois même le tyran avait l’appui et le soutien des couches populaires contre les élites.
Aujourd’hui, le terme a une connotation à la fois négative et abusive. Le mot « tyran » a acquis depuis minimalement le siècle dernier[10], une connotation fortement négative. Il désigne une personne (chef d’État, dictateur, etc.) qui exerce son pouvoir de façon arbitraire, cruelle, oppressive, en abusant de son autorité et sans respect des lois ni des droits. Il évoque aujourd’hui plus concrètement un pouvoir absolu exercé de façon despotique et souvent violente. Le tyran a peu ou prou de légitimité morale ou politique en raison du fait de sa gouverne politique qui se caractérise par le recours à la terreur, l’injustice, la cruauté et l’absence de respect des libertés individuelles.
En résumé, le tyran de la Grèce antique était un usurpateur du pouvoir, parfois toléré ou soutenu, alors que le tyran actuel désigne avant tout un dirigeant abusif dont le règne est associé à la violence, à l’oppression et au totalitarisme.
Mais le tyran (abuseur) peut être n’importe qui
Apportons la nuance exprimée plus tôt sur notre interprétation de la position d’Épictète au sujet de la tyrannie — prise dans son acception péjorative — et du détachement des choses extérieures, comme le pouvoir politique. Marc-Aurèle, qui s’inspira de la philosophie stoïcienne durant son règne, voyait aussi l’adversaire militaire comme un potentiel tyran, au même titre que son entourage et sa population pouvaient se montrer tyranniques envers lui. Parce que l’expression de la tyrannie déborde de la définition coutumière de l’époque, comme tente de nous le faire comprendre Épictète. Tout le monde peut devenir le tyran de quelqu’un d’autre, en s’octroyant une force et des privilèges qui pourtant ne lui appartiennent qu’en vertu du fait que nous les lui accordons ; et ce, même si nous n’en pouvons rien. Mais un César, un maître ou n’importe quelle personne capable d’exercer un pouvoir peut devenir certes tyran, y compris être sage et bon.
L’enseignement d’Épictète se destine à quiconque aspire à la tranquillité d’esprit et à la liberté, comme nous l’avons souligné, soit, en même temps, des qualités attribuées à la sagesse. Par conséquent, le dirigeant ou la dirigeante, qui recherche la vertu sans s’illusionner, doit rester les deux pieds sur terre et se questionner sur ce qui est le plus important, c’est-à-dire, en premier lieu, tendre vers ce qui dépend de sa personne, puis, en second lieu, profiter avec humilité de ce que le monde extérieur lui procurera. Au bout de la ligne, la tyrannie, prise dans le sens de ce qu’elle peut générer en termes d’abus, est la manifestation de quelqu’un qui souhaite incarner ce qu’elle n’est pas et ne pourra jamais être, sans se faire du tort ainsi qu’aux autres. D’où un chemin tortueux qui le ou la mènera évidemment vers des tourments incessants et l’échec inévitable. Ainsi, la liberté correspond également à avoir l’esprit libre de toutes chimères créées à partir d’une imagination de ce que doit représenter le pouvoir, la richesse, le prestige et les honneurs ; voire cette imagination qui amène en plus la personne à croire qu’elle incarne sur terre le pouvoir, la richesse, le prestige et les honneurs.
Ainsi, Épictète ne tente pas seulement de faire accepter leurs conditions à ceux et celles qui subissent des ordres ou un commandement, mais d’aider aussi les dirigeants et les dirigeantes à agir en conscience de cause et surtout à partir d’un précepte fort simple qui oblige à regarder les faits tels qu’ils sont au lieu de leur attribuer, en plus de s’attribuer, une valeur mensongère basée sur l’opinion, le jugement ou encore le culte des possessions. Et il est là leur défi : comment être capable de s’occuper à la fois de soi et des autres qui forment la société à gouverner, sans perdre la tête. C’est à ce niveau également que la tendance manichéenne de l’humain matérialiste et amoureux des voluptés les amènera à imposer ce qui fait leur affaire, au lieu de prendre le temps d’un recul réflexif susceptible d’aboutir à une solution davantage bénéfique pour la collectivité. Alors, le tyran, pour Épictète, est une personne qui a perdu son chemin pour elle-même et qui n’a donc aucune idée de sa place véritable parmi les autres et de ce qu’il faut faire pour contribuer au mieux-être commun ; elle est plutôt ancrée sur ce qu’elle croit qui serait le mieux à partir de ses représentations du comment l’extérieur doit fonctionner et sur ce qu’il doit lui apporter en termes de choses qui ne dépendent cependant pas d’elle.
Comme Épictète (2015a[1943], p. 24) l’a bien dit, « ce sont les difficultés qui révèlent les hommes », d’où le choix d’accepter de jouer ou de faire comme les enfants qui communiquent ouvertement leur souhait de ne plus jouer. Dans le premier cas, à quoi peut servir de se lamenter, sinon d’accroître sa propre souffrance et de toujours lorgner les biens que les autres possèdent et sur lesquels on n’y peut rien ; tandis que pour le tyran, la difficulté sera de pousser les autres à rencontrer son désir, alors que toute personne, aussi esclave soit-elle, possède sa propre volonté qui, à n’importe quel moment et sous n’importe quelle forme, s’opposera à son ordre, ce qui ne fera qu’augmenter sa frustration. Dans le second cas, le refus de jouer permet de s’en aller, ce qui ne signifie pas nécessairement une fuite physique, mais un allégement de l’esprit, afin de cesser de se fatiguer avec des idées qui augmentent la souffrance et donc s’attirer un peu plus de tranquillité ; tandis que le tyran peut aussi accepter de laisser aller certaines choses, l’amenant à gagner du temps pour se concentrer sur lui au lieu de maudire ses sujets qui ne l’écoutent plus et qui risquent en plus de le détester davantage, s’il ose multiplier les châtiments. En définitive, peu importe notre place au sein d’une société, Épictète nous amène à choisir la voie de la tranquillité, de l’apaisement des pulsions et des frustrations, en préférant la vie vécue au présent de façon à l’apprécier pour ce qu’elle est et pour soi-même. Le philosophe tente donc de nous convaincre de ceci :
« Souviens-toi que ce n’est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe, qui t’outrage ; mais c’est l’opinion que tu as d’eux, et qui te les fait regarder comme des gens dont tu es outragé. Quand quelqu’un donc te chagrine et t’irrite, sache que ce n’est pas cet homme-là qui t’irrite, mais ton opinion. Efforce-toi donc, avant tout, de ne pas te laisser emporter par ton imagination ; car, si une fois tu gagnes du temps et quelque délai, tu seras plus facilement maître de toi-même » (Épictète, 1971, p. 29).
En bref, l’enseignement partagé vise l’accalmie individuelle qui peut certes aider en politique à se concentrer sur l’essentiel, de façon à débrouiller l’esprit dans la prise de décision utile à la collectivité. Mais revient aussi dans les parages une interprétation qui suppose de laisser les uns les autres agir à leur guise, dans une sorte d’anarchie contrôlée dans ses pulsions, grâce à des préceptes prônant la maîtrise de soi ; ce qui peut d’ailleurs détonner d’un stoïcisme amoureux de l’ordre et des règles dans une structure généralisée, comme on voudra le garantir à une population. Voilà où apparaît l’influence de Socrate.
Conclusion
Il est permis de reprocher à Épictète de trop faire dans la passivité ou l’indifférence politique. Il prône une attitude trop passive face à l’injustice et à la tyrannie. Il invite à se limiter à la résistance intérieure et au détachement psychologique sans encourager l’action directe ou la lutte politique contre l’oppression. Cette posture correspond à une forme de résignation et/ou de complaisance envers le pouvoir établi : le sage se détourne de la résistance extérieure pour ne cultiver que sa liberté intérieure, au risque d’abandonner la société à la domination du tyran. Mais des questions méritent d’être soulevées ici : la liberté humaine est-elle seulement intérieure et individuelle ? Peut-on la concevoir comme étant complètement détachée des conditions concrètes de l’existence et de la justice sociale ? Épictète semble complètement disposé à laisser le champ libre au pouvoir arbitraire du tyran et ce tant que l’individu conserve sa sérénité intérieure. D’un point de vue politique, cette distance conduit à coup sûr à une faiblesse de la résistance collective et à une sous-estimation de la valeur de l’action civique ou de la solidarité. À moins d’éduquer le tyran aux préceptes de la philosophie, afin de l’amener à se replacer à l’intérieur de son être, malheureusement perdu dans ses passions et ses ambitions souvent démesurées.
En ramenant toute question politique à une question de représentation subjective et de disposition d’esprit, Épictète nous donne la forte impression qu’il banalise la souffrance, l’injustice et/ou la violence exercée par le tyran. Or, est-ce plutôt pour nous aider à comprendre à quel point sommes-nous habiles à exagérer nos souffrances, c’est-à-dire à faire de notre imagination l’artisane de notre authentique malheur ? Est-ce la vie qui doit être juste ou ce que nous en faisons pour nous-mêmes et les autres ? Cette vie doit-elle alors être jugée sur ce qu’elle est ou sur ce que nous imaginons d’elle seulement pour nous-mêmes ? Il n’empêche que même si Épictète fonde une éthique de la souveraineté subjective puissante pour briser l’emprise psychologique de la peur, sa doctrine reste pour nous nettement critiquable pour son insuffisance du point de vue de la résistance active, de la justice collective et de la transformation des rapports de pouvoir.
Annexe 1
Citations intéressantes puisées dans l’ouvrage ÉPICTÈTE. 1971. Manuel. Traduit par M. Dacier. Avignon : Aubanel, 79 p.
I.De toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous, les autres n’en dépendent pas. Celles qui en dépendent sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions ; en un mot, toutes nos actions. II. Celles qui ne dépendent point de nous sont le corps, les biens, la réputation, les dignités ; en un mot, toutes les choses qui ne sont pas du nombre de nos actions. III. Les choses qui dépendent de nous sont libres par leur nature, rien ne peut ni les arrêter, ni leur faire obstacle ; celles qui n’en dépendent pas sont faibles, esclaves, dépendantes, sujettes à mille obstacles et à mille inconvénients, et entièrement étrangères. (p. 7-8).
IV. Souviens-toi donc que, si tu prends pour libres les choses, qui de leur nature sont esclaves, et pour tiennes en propre celles qui dépendent d’autrui, tu trouveras partout des obstacles, tu seras affligé, troublé, et tu te plaindras des dieux et des hommes : au lieu que, si tu prends pour tien ce qui t’appartient en propre, et pour étranger ce qui est à autrui, jamais personne ne te forcera de faire ce que tu ne veux point ; ni ne t’empêchera de faire ce que tu veux ; tu ne te plaindras de personne ; tu n’accuseras personne ; tu ne feras rien, pas la plus petite chose, malgré toi ; personne ne te fera aucun mal, et tu n’auras point d’ennemi, car il ne t’arrivera rien de nuisible. (p. 8-9).
X. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu’ils en ont. Par exemple, la mort n’est point un mal, car, si elle en était un, elle aurait paru telle à Socrate, mais l’opinion qu’on a que la mort est un mal, voilà le mal. Lors donc que nous sommes contrariés, troublés ou tristes, n’en accusons point d’autres que nous-mêmes, c’est-à-dire nos opinions. XI. Accuser les autres de ses malheurs, cela est d’un ignorant ; n’en accuser que soi-même, cela est d’un homme qui commence à s’instruire ; et n’en accuser ni soi-même ni les autres, cela est d’un homme déjà instruit. (p. 14-15).
XIV. Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu’elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. XV. La maladie est un obstacle pour le corps, mais non pour la volonté, à moins que celle-ci ne faiblisse. « Je suis boiteux. » Voilà un empêchement pour mon pied ; mais pour ma volonté, point du tout. Sur tous les accidents qui t’arriveront, dis-toi la même chose ; et tu trouveras que c’est toujours un empêchement pour quelque autre chose, et non pas pour toi. (p 17-18).
XXI. Si tu veux que tes enfants et ta femme et tes amis vivent toujours, tu es fou ; car tu veux que les choses qui ne dépendent point de toi en dépendent, et que ce qui est à autrui soit à toi. De même, si tu veux que ton esclave ne fasse jamais de faute, tu es fou ; car tu veux que le vice ne soit plus vice, mais autre chose. Veux-tu n’être pas frustré dans tes désirs ? Tu le peux : ne désire que ce qui dépend de toi. (p. 22-23).
XXII. Le véritable maître de chacun de nous est celui qui a le pouvoir de nous donner ou de nous ôter ce que nous voulons ou ne voulons pas. Que tout homme donc, qui veut être libre, ne veuille et ne fuie rien de tout ce qui dépend des autres, sinon il sera nécessairement esclave. (p.23).
XXIX. Souviens-toi que ce n’est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe, qui t’outrage ; mais c’est l’opinion que tu as d’eux, et qui te les fait regarder comme des gens dont tu es outragé. Quand quelqu’un donc te chagrine et t’irrite, sache que ce n’est pas cet homme-là qui t’irrite, mais ton opinion. Efforce-toi donc, avant tout, de ne pas te laisser emporter par ton imagination ; car, si une fois tu gagnes du temps et quelque délai, tu seras plus facilement maître de toi-même. (p. 29).
Bibliographie
Aristote. 1971. La politique. Paris : Denoël Gonthier, p. 95-114.
Brunschwig, Jacques. 1996. « Stoïcisme antique ». In. Raynaud, Philippe et Stéphane Rials. Dictionnaire de philosophie politique. Paris : Presses Universitaires de France, p. 748-752.
De Crescenzo, Luciano. 1999. Les grands philosophes de la Grèce antique. Paris : Le livre de poche. p. 425-432.
Dégremont, Roselyne. 2014. « Épictète ». In. Zarader, Jean-Pierre (dir.). Dictionnaire de philosophie. Paris : Ellipses poche, p. 242-244.
Épictète. 1971. Le manuel d’Épictète. Avignon : Aubanel, 79 p.
Épictète. 1991. De l’attitude à prendre envers les tyrans. Paris : Gallimard, 130 p.
Épictète. 2015a[1943]. « Comment il faut combattre les difficultés ». In. Épictète. Du contentement intérieur et autres textes. Texte établi et traduit du grec ancien par Joseph Souilhé avec la collaboration d’Amand Jagu pour les extraits des livres III et IV. Paris : Les Belles Lettres/Gallimard, p. 24-28.
Épictète. 2015b. Entretiens. Fragments et sentences. Paris : Vrin, 537 p.
Épictète. 2015c. Manuel d’Épictète. Présentation par Laurent Jaffro. Paris : Garnier-Flammarion, 157 p.
Hadot, Ilsetraut. 1998. Dictionnaire des philosophes. Paris : co-édition Encyclopaedia Universalis/Albin Michel, p. 517-521.
Hermet, Guy, Bernard Badie, Pierre Birnbaum et Philippe Braud. 2015. Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques. Paris : Armand Colin, p. 305.
Hérodote. 1850. « Choix d’un gouvernement ». Livre III. THALIE. L’enquête. Paris : Charpentier, 1850. http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/thalie.htm. Consulté le 21 juillet 2020.
Mattei, Jean-François. 1984. « Épicure ». In. Huisman, Denis (dir.). Dictionnaire des philosophes A-J. Paris : Presses Universitaires de France, p. 866-873.
Million-Delson, Chantal. 1985. Essai sur le pouvoir occidental. Paris : Presses Universitaires de France, 252 p.
Platon. 1966. République. Paris : Garnier-Flammarion, (§544a à §557b), p. 304-316.
Platon. 2006. Les lois : Livres I à VI. Paris : Garnier-Flammarion, (§709e), p. 225.
Polybe. 1977. Histoires. Paris : Les Belles lettres, p. 71-80.
Polybe. 2003. Histoires. Paris : Gallimard, p. 549-559.
Notes
[1] Nuits attiques, XVII, 19. https://remacle.org/bloodwolf/erudits/aulugelle/livre17.htm. (Voir également :
https://psychaanalyse.com/pdf/BIOGRAPHIE%20D%20EPICTETE%20-%20WIKIPEDIA%20(7%20pages%20-%202%20mo).pdf.) Consulté le 1er novembre 2025.
[2] Les informations présentées ici ont été puisées dans l’introduction du livre Manuel d’Épictète (2015) rédigée par Laurent Jaffro et également dans Ilsetraut Hadot (1998, p. 517-521).
[3] Voir également le chapitre X, dans la traduction de Dacier (1971, p. 14) : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu’ils en ont ».
[4] Voir la citation I dans l’Annexe 1.
[5] En grec ancien, manuel s’écrit enkheiridion (« ce que l’on tient dans la main »). L’Académie française précise ceci : « XVIe siècle. Mot du bas latin, emprunté du grec egkheiridion, « poignard » (de kheir, « main », avec le préfixe en‑, « dans »). LITTÉRATURE GRECQUE ET LATINE. Manuel, recueil de préceptes. L’« Enchiridion » d’Épictète. » https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E1345. Consulté le 1er novembre 2025.
[6] Voir également dans la traduction de Dacier (1971, p. 14-15) : « XIV. Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu’elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours ».
[7] Voir également dans la traduction de Dacier (1971, p. 26) : « XXV. Souviens-toi que tu es acteur dans une pièce, longue ou courte, où l’auteur a voulu te faire entrer. S’il veut que tu joues le rôle d’un mendiant, il faut que tu le joues le mieux qu’il te sera possible. De même, s’il veut que tu joues celui d’un boiteux, celui d’un prince, celui d’un plébéien. Car c’est à toi de bien jouer le personnage qui t’a été donné ; mais c’est à un autre de te le choisir. ».
[8] Mattei (1984) excuse et justifie le détachement ou le non-engagement de la vie politique prôné par Épictète en raison de ceci : « A l’image de ses deux modèles, Socrate et Diogène, Épictète ne fuit pas le monde, s’il ne va pas à lui : il le laisse plutôt advenir, ou encore il laisse arriver les choses comme elles arrivent, en faisant à chaque fois ce que sa raison et la place qu’il occupe dans la cité lui commandent de faire. La solidarité militante dont il témoigne sans ostentation lui interdit de s’engager, [...], pour la bonne raison qu’il est déjà engagé dans la communauté des dieux et des hommes ; il a un poste » ( p. 865).
[9] Comme l’écrit Brunschwig (1996, p. 749) « l’adhésion au stoïcisme ne constitue pas un engagement à militer en faveur d’une politique particulière, à travailler par exemple à l’instauration ou au maintien d’un régime donné, monarchie, aristocratie ou démocratie ».
[10] « Tyrannie : Gouvernement d’un tyran, modalités d’exercice de son pouvoir sans frein, ou espace politique qui lui est soumis. Dans la Grèce antique, le tyran s’emparait du pouvoir et s’y maintenait par la force, au mépris de toute règle déjà établie ou simplement prévisible. Il pouvait toutefois bénéficier de l’assentiment populaire, et ce n’est qu’avec Platon et Aristote que la tyrannie s’est transformée en catégorie typologique connotée de manière totalement péjorative. Platon, en particulier, l’interprétait soit comme une corruption de la monarchie, soit comme un risque tendanciel inhérent à la démocratie. C’est Leo Strauss qui a renoué en 1946 avec l’usage du mot, devenu cher plus tard aux néo-conservateurs américains dans leur croisade pour la démocratie en tous lieux. » (Hermet, Badie, Birnbaum et Braud, 2015, p. 305).
…
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :






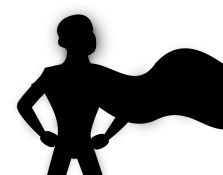

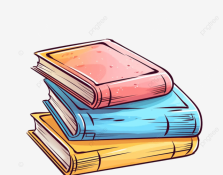




Un message, un commentaire ?