Il peut sembler prétentieux ou présomptueux a priori aux yeux de certains individus d’oser écrire un texte sur une personne qui a vécu à une période lointaine de nous et pour laquelle, en prime, nous détenons peu de choses nouvelles à dévoiler à son sujet. En effet, nous possédons uniquement quelques données sur la biographie de Thalès de Milet et un nombre limité de fragments de sa pensée. Néanmoins, malgré le fait que notre personnage ait déjà été scruté sous plusieurs de ses coutures, nous tenons quand même à commettre un texte non pas principalement sur lui, mais sur ce que nous semblons savoir sur lui. Plus spécifiquement, il sera également question d’une affirmation d’un philosophe britannique (Whitehead, pour ne pas le nommer), qu’on nous présente comme une donnée quasiment immuable ou incontestable (Canto-Sperber, 1998 et tutti quanti). Dans les lignes qui suivent, nous allons discuter de choses connues pour certaines lectrices et certains lecteurs. On y trouvera également une précision susceptible d’intéresser, espérons-le, quelques-unes et quelques-uns parmi vous.
Ce que l’histoire a retenu sur Thalès de Milet
Les manuscrits de l’Antiquité ne nous sont pas parvenus en totalité. Il nous en manque plusieurs et ceux que nous avons ne sont pas toujours dans leur version intégrale. Nous connaissons Thalès de Milet grâce à deux sources : Aristote et Diogène de Laërce qui ont écrit sur ce scientifique-philosophe plusieurs siècles après sa mort. Il n’est pas facile, dans ces circonstances, de discerner le vrai du faux, la fable du vraisemblable. L’Histoire avance ou retient que Thalès est le premier d’une lignée importante de penseurs ayant vécu à Milet (d’où l’expression « École de Milet » ou « penseurs milésiens »). Il est le plus ancien des Sept Sages. C’est lors d’un voyage en Égypte qu’il a étudié les sciences. Astronome et géomètre, on rapporte qu’il a été le premier, en raison de ses connaissances réputées positives dans ces deux domaines scientifiques, à prédire d’abord, sur une base rationnelle, les éclipses solaires et les solstices, ensuite à fixer à 30 jours la durée d’un mois. Et simplement pour ajouter à la liste de ses réalisations, il aurait rédigé un « guide nautique », mesuré, dit-on, la dimension du soleil ainsi que son passage « d’un tropique à l’autre », calculé la hauteur des pyramides par la longueur de leur ombre et leur propre taille, découvert la constellation de la Petite Ourse et détourné le cours du fleuve Halys pour faciliter le déplacement des troupes armées du roi de Lydie. Il est aussi célèbre pour avoir prédit l’Éclipse du 28 mai de l’an -585 (Hérodote, 1985, Livre I, §74) et était d’avis que la Terre représentait un cylindre qui flottait avec de l’eau au-dessus et au-dessous. Prédisant une abondante récolte d’olives, il aurait loué, à très bas prix, la totalité des pressoirs à huile de Milet. Quand le moment de la récolte fut arrivé, la demande pour les pressoirs explosa. Thalès les sous-loua à un montant qui lui permit d’amasser une somme substantielle. Il n’est pas exagéré de dire qu’il s’est enrichi à l’aide de la spéculation sur des pressoirs à huile d’olive. Occupé à contempler le ciel en marchant, il tomba dans un trou. Ce qui aurait fait dire, à une servante de Thrace, que Thalès « dans son ardeur à savoir ce qu’il y a dans le ciel, il ignorait ce qu’il y avait devant lui, même à ses pieds. » (Platon, Théétète, 1995, 174a-b). Heureusement, il croyait à l’immortalité de l’âme[1].
Diogène de Laërce avance que Thalès de Milet aurait eu une carrière politique avant de s’intéresser à la science de la nature (la physique), au point même de jouer un rôle important dans sa patrie (Diogène Laërce, 1999, p. 80 et 82). Selon Hérodote, Thalès aurait conseillé la création d’une assemblée centrale unique à Milet et la reconnaissance de certaines villes comme États autonomes. Ce qui témoigne, selon nous, d’une réflexion positive sur l’organisation politique visant à la stabilité et à la cohésion civique (voir à ce sujet Hérodote, 1985, Livre I, §170).
Sur les croyances de son époque et sur l’originalité de son point de vue
Égyptiens et Babyloniens étaient d’avis que l’eau constituait l’élément primordial de la vie, mais le principe d’explication de la création de l’Univers résidait dans l’action et l’intervention divine. Pour les Milésiens, qui n’évacuaient pas complètement et également le divin, les explications devaient provenir de la nature ou de la physique naturelle. Par exemple, les tremblements de Terre n’avaient rien à voir, selon Thalès et certains Milésiens, avec la colère des dieux. Il s’agissait plutôt d’un phénomène produit par l’agitation de l’eau sur laquelle flottait la Terre. D’ailleurs la Terre, selon Thalès, aurait émergé des « Eaux primordiales » et « génitales ». Il utilisait le terme d’Archè pour désigner la chose première et unique (le Principe), à savoir justement l’eau, voire l’éternel principe à partir duquel l’humide devient la semence de tous les êtres vivants, y compris des éléments utiles à leur développement (Leclère, 1908). Apparaît ainsi l’idée de la transmutation ou de la métamorphose qu’on cherchera plus tard à rendre cohérente avec la croyance aux divinités et à leur pouvoir créateur ou régulateur, dans la mesure où ledit pouvoir s’incarnerait dans les qualités de la nature.
Mais il importe de préciser ici que même Thalès est l’héritier et le produit d’un ou de plusieurs savoirs antérieurs de son époque. Il est incontestablement un des premiers précurseurs de la science grecque et sera suivi d’Anaximandre (vers -611 à -547) pour qui la Terre est au centre de l’Univers (vision géocentrique qui sera remise en question pas Copernic au XVe siècle de notre ère) et d’Anaximène (vers -550 à -475) qui croyait que l’élément primordial de l’Univers était plutôt l’air.
Un héritage pour les Grecs et d’autres encore
D’ailleurs, il devient intéressant de suivre les traces des successeurs de Thalès, dans la mesure où Anaximandre remit en question l’idée que l’eau ou tout autre corps soit la matière primordiale de toutes choses, pour s’intéresser à la place au mouvement. Son geste annoncera l’atomisme, notamment avec Démocrite (né vers -460 et décédé vers -370), mais influencera également la philosophie d’Héraclite (né vers -550 et décédé vers -480) sur le mouvement, alors que le feu désigne pour ce dernier le Principe de l’Univers. Ainsi, cet élève de Thalès considérait la densité et le mouvement comme des explications de l’existence du monde et du vivant, alors que :
« le premier de ces principes détermine la place de l’air, celle du feu, celle de la terre jadis couvert d’eau comme le prouvent les coquillages qu’on rencontre jusque sur les montagnes ; les deux principes réunis rendent compte des phénomènes atmosphériques ; et le second cause ces tourbillons, ces anneaux d’air feutré à travers lesquels il se produit des trous qui laissent voir du feu arraché aux parties les plus hautes du ciel ; les astres ne sont pas autre chose que ce feu » (Leclère, 1908, p. 25).
On en déduisit ensuite l’avènement des êtres vivants par combinaison des éléments, mais ici la dimension divine est évacuée pour laisser place à une doctrine de l’évolution universelle ! Un parallèle peut être fait aisément avec le Timée de Platon (2020b), alors que la création de toutes choses dans leur forme implique une intervention divine, afin de disposer des éléments de façon appropriée. Alors si Platon attribue la naissance des êtres vivants à une descente des dieux démiurges, Anaximandre, inspiré par Thalès, insinue plutôt une amélioration des êtres nouveaux par rapport à leurs prédécesseurs, supposant aussi une meilleure adaptation qui sera démontrée beaucoup plus tard avec Charles Darwin.
Pour sa part, Anaximène tenta de préciser le mouvement décrit par son collègue de l’École de Milet. Comme nous l’avons dit, celui-ci attribua à l’air le Principe primordial, puisqu’il « est plus actif, contient tout, est en tout, est tout, gouverne tout ; éternel et toujours égal à lui-même, il est l’étoffe dont se forment ce en quoi se résorbent indéfiniment les mondes ; il est le divin même, les grands corps qui se produisent dans son sein étant seulement des dieux périssables » (Leclère, 1908, p. 27). Évacuant à la fois les dieux et le surnaturel, sa théorie sur le mouvement se comprend à travers la condensation et la raréfaction de l’air, ce qui est totalement naturel et rend même possible la transmutation. Car son épaississement crée le vent, ensuite les nuages, les précipitations, avec des effets sur la terre jusque dans la pierre qui en possède. Mais en raréfiant l’air, le feu surgit. Or, cette succession visible ou pouvant être ressentie, puisqu’étant de l’ordre de l’expérience, ouvre à une réflexion sur la relation entre l’être observateur et son milieu de vie, d’où la perspective de pouvoir approfondir la question de la subjectivité à partir de la raison.
Un pas suffisait pour inspirer la doctrine des quatre éléments, dont l’auteur, Empédocle (né vers -490 et décédé vers -435), voyait dans la combinaison de l’eau (Thalès), de l’air (Anixamène), de la terre (Pythagoriciens) et du feu (Héraclite), à partir de doses variées, la raison d’être de la matière à la fois dans ses perfections et ses défauts (Leclère, 1908). Il joignit au tout deux autres éléments, c’est-à-dire l’Amour et la Haine, qui servent de principes spirituels ou de manifestations de l’activité divine au sein de l’Univers. Par conséquent, les corps ne sont pas des unités ou des masses dans lesquelles un dualisme incessant persiste, mais représentent bel et bien un ramassis de plusieurs éléments, sans toutefois rien enlever à la croyance de l’unité du monde. Depuis Thalès, l’unité des choses représentait un principe admis. Parménide (né vers -515 et décédé vers -440), en songeant notamment au texte de Platon (2020a), a su exposer avec l’analogie de la toile, l’idée de l’unicité obtenue en recouvrant plusieurs personnes sur un espace donné, pour ainsi former « un » groupe. Il n’empêche que la pluralité existe elle aussi. Anaxagore (né vers -500 et décédé vers -428), a qui on attribue la maxime « le tout est dans les parties et les parties dans le tout », avait pour doctrine que « [t]oute naissance est une agrégation de semblables et de dissemblables, toute mort est désagrégation » (Leclère, 1908, p. 86). Ainsi, il diffère d’Empédocle en minimisant les possibilités d’agrégations, de façon à suggérer des parties obligatoires pour chaque espèce formant ensemble le vivant, étant donc comparables sans être totalement semblables. Restait toutefois à élucider l’énigme principale posée en quelques questions : pourquoi ces agrégations se produisent-elles ? quelle intelligence en serait la cause ? et pour quelle raison l’être vivant perd-il sa vie pour devenir un cadavre ? Ceci animera plus tard les discussions philosophiques sur le thème de l’être. Et à chaque fois, autant chez Platon, Aristote que Zénon, mais très peu chez Épicure, pour ne nommer que ceux-là, l’intervention divine refait surface avec la mention d’une (ou de quelques) âme(s) nécessaire(s).
Mais avant d’arriver à ces philosophes, Thalès a su également toucher Socrate, alors qu’il serait, selon Diogène de Laërce (1999, p. 92), l’auteur de l’expression « connais-toi toi-même ». D’ailleurs, Thalès avait aussi pour principe que toutes expériences devaient faire l’objet de la raison, à savoir un conseil philosophique visant justement à tenter de comprendre ce qui se passait, à évaluer ce qui peut être retenu et, en l’occurrence, à parvenir à mieux se connaître.
Sur une assertion pompeuse et nettement exagérée de Whitehead au sujet de Platon
Il faut se méfier, selon nous, des affirmations péremptoires ou ex cathedra de grands maîtres à penser du genre de Whitehead, d’après lesquelles notamment « [l]a façon la plus sûre de caractériser la tradition philosophique européenne est qu’elle consiste en une série de notes de bas de pages à Platon » (Canto-Sperber, 1998, p. 185). La citation qui semble la plus exacte sur cette conclusion hâtive consiste plutôt à ceci : « Le plus sûr, pour caractériser la tradition philosophique européenne en général, est de reconnaître qu’elle consiste en une succession d’apostilles à Platon » (Whitehead, 1995, p. 198). La formule est à la fois concise, spectaculaire et, pour sûr, très maladroitement erronée. Elle est même trop succincte ou condensée pour être prise au sérieux car, si Thalès a eu des prédécesseurs et qu’il est lui-même l’auteur « d’apostilles » aux mythes et aux scientifiques égyptiens, on peut présumer, sans grand risque de se tromper, qu’il en a été de même pour Platon à l’endroit de la mythologie et des « présocratiques » (les « Sept Sages » de l’Antiquité). Citer abondamment un auteur (ou une autrice) expose certaines choses : premièrement, sa popularité ; deuxièmement, sa popularité obtenue grâce à d’autres autrices et auteurs reconnuEs ou les plus visibles ; troisièmement, sa popularité à défaut d’avoir pu rendre visibles d’autres grands noms malheureusement oubliés ou même tassés pour des raisons idéologiques ou politiques ; quatrièmement, sa popularité réanimée grâce à une revisite soudaine ou une trouvaille inespérée, alors que les thèmes traités, y compris la façon de les exploiter, demeurent sans âge. Face à une autrice ou un auteur populaire, le réflexe est de chercher à savoir pourquoi cette personne l’est, de s’y intéresser à travers plusieurs de ses oeuvres, ce qui insinue tout autant d’approfondir les raisons en se concentrant à la fois sur ses sources d’inspiration, les critiques qu’elle a reçues et même sur ses adversaires ou alliéEs, dont les idées oubliées ou volontairement dissimulées pourraient compléter, sinon corriger les siennes, de façon à nous aider à améliorer notre présent et notre avenir.
Pour conclure
Thalès a soutenu que « l’eau est le Principe de toutes choses » : il a cherché à comprendre ce qui constitue le fondement du réel non pas dans une cause surnaturelle ou divine, mais dans un élément physique. Cette proposition marque résolument une rupture dans l’histoire de la pensée, car elle vise une explication universelle. En privilégiant l’enquête rationnelle (le « logos ») sur le récit mythologique (« muthos »), Thalès a inauguré une démarche intellectuelle nouvelle, qui a eu pour effet de considérer l’univers comme intelligible et régi par des lois naturelles. Il a fondé ainsi ce qu’on appellera plus tard la « philosophie de la nature ». L’influence de Thalès est considérable : il est à l’origine de l’École de Milet, dont sont issus Anaximandre (avec l’apeiron comme Principe) et Anaximène (pour qui l’air est le Principe de toutes choses). Il a introduit une méthode rationnelle d’observation et d’explication qui sera approfondie, nuancée ou contestée par d’autres philosophes identifiés aux présocratiques et leurs successeurs. Néanmoins, la thèse de l’eau comme archè proposée par Thalès était révolutionnaire, parce qu’elle a marqué une rupture fondamentale avec l’explication mythologique du monde et a inauguré un principe de compréhension naturaliste dans le tableau de la composition de la réalité.
Parmi les choses difficiles, il y a celle qui consiste à identifier le premier moment qui marque un changement, une rupture ou l’avènement d’une nouveauté. Reconnaissons-le, il n’est ni simple ni facile d’effectuer des coupes franches dans l’épais magma du réel. Parmi les grandes énigmes toujours irrésolues, il y a celle-ci : quand a commencé vraiment la philosophie et qui est le personnage qui aurait initié ce mouvement de la pensée critique ? La recherche du point de départ se brouille et se complexifie quand des auteurs incontournables d’une discipline y vont d’affirmations péremptoires du genre de celle de Whitehead. Platon et même Thalès ont eu des prédécesseurs. Eux aussi sont des notes de bas de page ou plutôt des « apostilles » aux mythes ou aux croyances de leur époque, ou qui perduraient à leur époque. Faire débuter la philosophie à partir de Platon (ou de Socrate) constitue une erreur d’appréciation de la portée réelle de plusieurs de ses prédécesseurs. Parler d’auteurs « présocratiques » est une expression inadéquate, selon nous. Il faut s’intéresser aux premières sources, orales ou écrites, de la Grèce Antique pour entendre ou pour lire les réponses aux questions : « D’où venons-nous ? » et « Qui sommes-nous ? ».
Il n’est pas facile d’entrer dans les pensées, qui semblent achevées, des grands maîtres de la Grèce classique du IVe siècle, tels Platon ou Aristote, si l’on ne prend pas en considération la manière dont ce qui est réputé correspondre aux sciences rationnelles (arithmétique, géométrie, médecine, philosophie, histoire, etc.) ont pris forme et ont vu le jour. C’est en ayant conscience de cette impérieuse nécessité d’aller le plus loin possible aux sources premières de la pensée rationnelle, donc philosophique, que nous avons cru bon d’effectuer un détour du côté de Thalès de Milet. Les commencements de la philosophie et de la science remontent minimalement aux Milésiens qui ont comme premier initiateur connu nul autre que Thalès de Milet. Il est, à ce moment-ci, la première source connue de l’émergence d’une pensée qui a contribué à jeter les bases de la philosophie, osons dire occidentale comme point de départ et de façon générale parmi d’autres grands noms plus ou moins connus et peut-être aussi oubliés.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
22 novembre 2025
23h
Annexe
On attribue à Thalès de Milet les sentences suivantes :
« Le plus ancien des êtres : Dieu, car il est incréé. Le plus beau : le monde, car c’est l’oeuvre de Dieu, le plus grand : le lieu, car il comprend toutes choses. Le plus rapide : l’intellect, car il court à travers tout. Le plus puissant : la Nécessité, car elle maîtrise toutes choses. Le plus sage : le temps, car il découvre tout ».
Il disait que la mort ne diffère en rien de la vie.
Comme on lui demandait ce qui était difficile, il dit : « Se connaître soi-même ». Ce qui est aisé ? « Conseiller les autres ». Le plus plaisant ? « Réussir ». Qu’est-ce que le divin ? « Ce qui n’a ni commencement ni fin ». Qu’avait-il vu de (plus) désagréable ? « Un tyran devenu vieux ». Comment peut-on supporter l’infortune le plus facilement ? « En voyant ses ennemis connaître des ennuis encore pires ». Comment mener la vie la meilleure et la plus juste ? « En ne faisant pas nous-mêmes ce que nous reprochons aux autres ». Qui est heureux ? « Celui qui est sain de corps, plein de richesses en son âme, bien éduqué naturellement » (Diogène Laërce, 1999, p. 89).
Il dit de se souvenir de ses amis, qu’ils soient présents ou absents. Ne pas s’embellir extérieurement, mais être beau par ses activités. « Ne t’enrichis pas de façon mauvaise, dit-il, et qu’une parole ne te discrédite pas auprès de ceux qui partagent ta confiance ». « Les contributions, dit-il, que tu as apportées pour tes parents, attends les mêmes aussi de la part de tes enfants ». (Diogène Laërce, 1999, p. 90)
Il serait l’auteur de la maxime suivante : « Connais-toi toi-même » (Diogène Laërce, 1999, p. 92).
Note
[1] La totalité des informations mentionnées dans ce paragraphe ont été puisées dans les sources suivantes : Bréhier, 2012, p.37-43 ; Brouillette, 2025, p. 36-37 ; Diogène Laërce, 1999, p. 77-87 et Ramnoux, 1998, p. 1488-1489.
Références
Bréhier, Émile. (2012). Histoire de la philosophie. Paris, France : Presses Universitaires de France, p. 1-79.
Brisson, Luc et al. (dir.). (2012). Lire les présocratiques. Paris, France : Presses Universitaires de France, 232 p.
Brouillette, Xavier. (2015). Aux origines de la philosophie occidentale : Les présocratiques. Montréal, Canada : Les éditions CEC, 88 p.
Brun, Jean. (1968). Les présocratiques. Paris, France : Presses Universitaires de France, 128 p.
Canto-Sperber, Monique. (1998). « Platon ». In. Philosophie grecque. Paris, France : Presses Universitaires de France, p. 185-299.
Collectif. (1988). Les présocratiques. Paris, France : Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, p. 3-23.
De Crescenzo, Luciano. (1999). Les grands philosophes de la Grèce antique. Paris, France : Le Livre de Poche, p. 32-38.
Diogène Laërce. (1999). Vies et doctrines des philosophes illustres. Paris, France : Le Livre de Poche, p. 65-95.
Dumont, Jean-Paul. (1988). « Préface ». In. Les présocratiques. Paris, France : Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, p. IX-XXV.
Hérodote. (1985). L’Enquête. Livres I à IV. Paris, France : Folio classique, 608 p.
Leclère, Albert. (1908). La philosophie grecque avant Socrate. Aris, France : Éditions Librairie Bloud & Cie., 127 p.
Platon. (1995). Théétète. Paris, France : GF Flammarion, 413 p.
Platon. (2004). Les mythes de Platon : Anthologie. Paris, France : GF Flammarion, 278 p.
Platon. (2020a). « Parménide ». In. Luc Brisson (dir.), Platon oeuvres complètes. Paris : Flammarion, p. 1105-1170.
Platon. (2020b). « Timée ou Sur la nature ; genre physique ». In. Luc Brisson (dir.), Platon oeuvres complètes. Paris : Flammarion, p. 1977-2050.
Ramnoux, Clémence. (1998). « Thalès de Milet (-625 env.-env. -547) ». In. Dictionnaire des philosophes. Paris, France : Encyclopedia Universalis/Albin Michel, p. 1488-1489.
Volquin, Jean. (1964). « Introduction ». In. Les penseurs grecs avant Socrate : De Thalès de Milet à Prodicos. Paris, France : GF Flammarion, p. 5 à 24.
Whitehead, Alfred North. (1995). Procès et réalité : Essai de cosmologie. Paris, France : nrf Éditions Gallimard, 579 p.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :



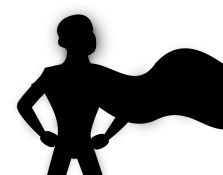

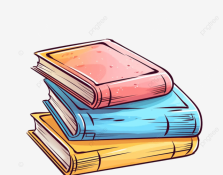







Un message, un commentaire ?